« Quand à la fin de La Force des choses j’ai enfreint ce tabou, quel tollé j’ai
soulevé ! Admettre que j’étais au seuil de la vieillesse c’était dire qu’elle guettait
toutes les femmes, qu’elle en avait déjà saisi beaucoup. Avec gentillesse ou avec
colère un grand nombre de gens, surtout de gens âgés, m’ont abondamment
répété que la vieillesse, ça n’existe pas. Il y a des gens moins jeunes que d’autres,
voilà tout. » Simone de Beauvoir, La Vieillesse (Introduction)
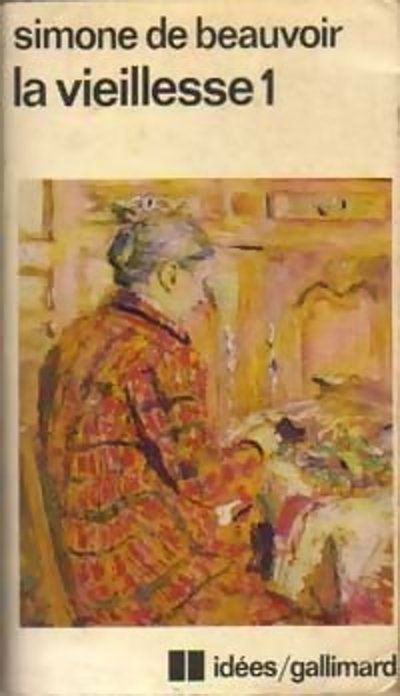 C’est en 1970, après avoir franchi le seuil des 65 ans qu’elle avait elle-même fixé comme lisière de sa propre vieillesse, que Simone de Beauvoir écrit cette somme qu’est La Vieillesse.
C’est en 1970, après avoir franchi le seuil des 65 ans qu’elle avait elle-même fixé comme lisière de sa propre vieillesse, que Simone de Beauvoir écrit cette somme qu’est La Vieillesse.
Somme en effet, puisqu’il s’agit, ni plus ni moins, de réunir l’ensemble des données recueillies sur ce phénomène qui concerne autant l’histoire que la médecine, autant la sociologie que la philosophie, autant la littérature que l’ethnologie.
Cependant, la démarche adoptée se veut résolument pragmatique et phénoménologique, puisque la méthode d’enquête qu’adopte Simone de Beauvoir ne consiste pas à désubstantialiser la vieillesse en privilégiant un point de vue théorique ou formel, mais au contraire à nouer ensemble et faire se rejoindre au sein d’un même corps (le sien), l’ensemble des analyses possibles sur la vieillesse et le fait de vivre l’état d’être-vieux.
Car, on peut se demander en effet s’il est possible d’adopter sur ce phénomène qui consacre une forme d’aveuglement sur soi-même un point de vue strictement objectivant. Certes, c’est toujours l’autre qui est vieux, et le vieillard qu’est-il sinon celui qui fait l’épreuve de l’altérité à l’égard de lui-même dans le spectacle qu’il se donne à soi de sa lente décrépitude. Pour autant, cette altérité ressentie n’est peut-être qu’une manière de mettre à distance ce qui nous blesse déjà par sa seule menace, – menace dont on sait bien qu’elle sera mise à exécution.
Est-il même possible de penser la vieillesse ? « La difficulté, écrit Simone de Beauvoir, c’est qu’on ne peut prendre sur elle ni un point de vue nominaliste, ni un point de vue conceptualiste. La vieillesse, c’est ce qui arrive aux gens qui deviennent vieux ; impossible d’enfermer cette pluralité d’expériences dans un concept ou même dans une notion. »
D’où le tabou et le scandale de l’absurde de parler de sa propre vieillesse : comme le vieillard sommait l’ensemble des autres hommes à se regarder eux-mêmes et dans le geste même de ce regard de vérité à cesser de « délocaliser » leur inquiétude vers autrui. Si l’enfance, l’adolescence et même la maturité sont loués en tant qu’ils sont des âges du passage et de la frontière que tout individu se doit de franchir pour s’accomplir pleinement ; au contraire, la vieillesse est envisagée sur le mode régressif de la perte : perte d’autonomie, de capacités physiques, d’horizons de vie. A ce titre, la vieillesse constitue l’envers et comme la doublure inquiétante de l’ensemble de la vie de l’homme, comme sa frontière définitive : être vieux n’est plus dès lors un moment de la vie, c’est le premier instant de la mort. Voilà en quoi consiste l’indécence du vieillard parlant de lui-même : sa voix paraît une forme d’outrecuidance de la mort s’arrogeant un espace dans le monde des vivants. Tel Faust, dans le roman de Goethe, observant par le soupirail de son laboratoire la fête du printemps où les jeunes gens insouciants célèbrent l’amour et la vie, croient-ils, qui est devant eux, éternelle.
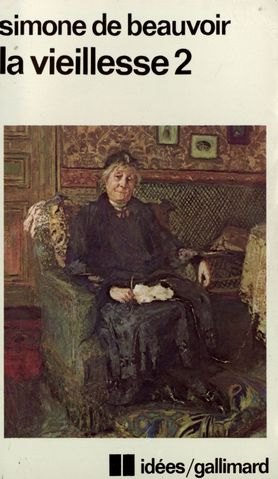 Brisure en soi de l’être vieux : « La vieillesse est « un rapport dialectique entre mon être-pour autrui, tel qu’il se définit objectivement, et la conscience que je prends de moi-même à travers lui. En moi, c’est l’autre qui est âgé, c’est-à-dire, celui que je suis pour les autres : et cet autre, c’est moi. »
Brisure en soi de l’être vieux : « La vieillesse est « un rapport dialectique entre mon être-pour autrui, tel qu’il se définit objectivement, et la conscience que je prends de moi-même à travers lui. En moi, c’est l’autre qui est âgé, c’est-à-dire, celui que je suis pour les autres : et cet autre, c’est moi. »
Brisure et déformation. Car si être vieux, c’est être exclu, cette exclusion ne commence pas dès lors que l’on relègue les vieillards dans des institutions spécialisées, ou comme le fait remarquer Véronique Le Ru, lorsqu’on escamote le génitif dans les appellations administratives relatives à la prise en charge sociale de la vieillesse (« politiques-vieillesse », « dépenses-vieillesse », « minimum-vieillesse » etc). « L’escamotage du « de », l’oubli du génitif remplacé par un trait d’union signifie toujours la technicisation ou encore la réification d’une notion, en l’occurrence du terme « vieillesse », qu’on transforme subrepticement en donnée quantitative et objective. » (Véronique, Le Ru, La vieillesse, De quoi avons-nous peur?)
Cette exclusion est au contraire « auto-immune » et diffractée à la fois : elle est constituée par l’ensemble de ces regards qui se portent sur un être et le qualifient silencieusement de « vieux ». Ces regards qui sourdement définissent une essence de « l’être-vieux » : et c’est dès lors sur la foi irrécusable de l’ensemble de ces regards muets et péremptoire que l’individu se sait être vieux. Implacable certitude, rets du regard qui enclos dans son rôle nouveau et sans issue, l’individu introjectant le point de vue d’autrui sur lui-même, s’appropriant ce point de vue au point d’en défaire l’origine étrangère et de le vivre comme une résolution propre : « Je suis vieille, puisqu’on me laisse cette place dans le métro que je n’ai pas demandée. »
Etre passif à qui l’on assigne sa définition irrécusable (là où l’enfant ou l’adolescent se voit reconnaître le droit d’échapper à toute définition par sa nature d’être de transition et de passage).
Que cet être en vienne à refuser la passivité qu’un regard implacable lui attribue arbitrairement, et voici le « tabou » enfreint et le « tollé » généralisé.
L’ouvrage de Simone de Beauvoir, plus de quarante après sa rédaction, nous rappelle à cette nécessaire « conversion du regard » que nous avons sur la vieillesse : âge de la vie, et non de la mort.
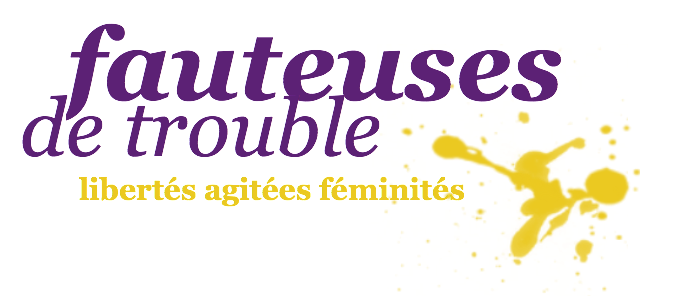


Commentaires récents