Le Sang d’un poète « n’est qu’une descente en soi-même, une manière d’employer le mécanisme du rêve sans dormir [...]. Les actes s’y enchaînent comme ils le veulent, sous un contrôle si faible qu’on ne saurait l’attribuer à l’esprit. Plutôt à une manière de somnolence aidant à l’éclosion de souvenirs libres de se combiner, de se nouer, de se déformer jusqu’à prendre corps à notre insu et à nous devenir une énigme. » (Jean Cocteau, La Difficulté d’être).
Sang-tête : l’obstination du réel
Le sang d’un poète est d’abord une expérience.
Une expérience cinématographique qui constitue pour ainsi dire un art poétique structuré à la manière d’une interrogation volontairement erratique de l’imago du poète. Si, littéralement, l’imago est apparence figée dans un masque de la vie prête à se perdre, alors il conviendra de voir dans ce « discours de la méthode » plastique qu’est Le sang d’un poète la déclinaison ininterrompue de la lutte que mène toute image contre sa propre disparition : paradoxe de l’évanescence simultanée de vingt-quatre images par seconde.
Le film est tourné en 1930. Il s’agit d’une commande du Vicomte de Noailles qui jouait alors un rôle de mécène auprès des artistes (c’est ainsi lui qui finança le film de Luis Buñuel, L’Age d’or).
Jean Cocteau ne connaissait rien aux techniques du cinéma. Mais l’approximation technique dont il fit preuve sera comme retournée vers elle-même et contribua grandement à l’inventivité poétique et plastique du film. C’est ainsi, par exemple, qu’ignorant tout du travelling, Jean Cocteau, au lieu de faire avancer la caméra vers le personnage, plaça au contraire ce dernier sur des rails afin de le faire avancer vers l’objectif. Le résultat à l’écran en est une représentation quasi irréelle des mouvements.
Le film s’organise à la manière d’un triptyque dont chacune des parties est à la fois autonome et parfaitement, quoi que selon la logique du rêve, reliée à la précédente.
Le 11 Mai 1745, alors qu’il est en train de peindre un visage, un peintre-poète reçoit la visite de son double qui, aussitôt la porte ouverte, fuit, comme sous le coup d’une vision terrifiante. Le poète referme la porte et de nouveau face à son chevalet, efface la bouche du portrait qu’il était en train de peindre. Cette bouche demeurera inscrite sur sa main et ne cessera de s’adresser à lui.
Pour s’en débarrasser, le peintre fixe cette bouche sur le visage vide d’une statue, laquelle lui ordonne alors d’oser enfin traverser le miroir qui se trouve dans la chambre. Hésitant, le poète « plonge » néanmoins dans la glace laquelle débouche sur un couloir.
Le deuxième moment du triptyque s’ouvre alors : le couloir d’un hôtel. Le peintre-poète ne peut voir à l’intérieur des chambres qu’en plaçant son œil au trou de la serrure : il assistera ainsi tour à tour à l’exécution indéfiniment réitérée d’un mexicain tombant sous les balles, à la leçon de vol d’une petite fille; il pourra aussi observer un hermaphrodite allongé sous un rotosphère se déchirant (littéralement, car elles sont de papiers) les chairs. Au bout du couloir, une main surgit du mur, tendant au poète un pistolet et énumérant, comme dans une notice d’utilisation, les étapes à suivre pour se tirer une balle dans la tête. Les instructions sont suivies, le sang coule, puis le poète rentre, déçu de son aventure, dans sa chambre. « Les miroirs feraient mieux de réfléchir avant de renvoyer les images ».
Dans le troisième moment qui s’ouvre alors, le poète doit jouer aux cartes avec la statue qui a pris l’apparence d’une femme à la beauté glaçante. S’il n’a pas l’as de cœur « il est un homme mort ». Un adolescent tué peu avant d’une boule de neige en plein cœur lui donne l’occasion de tricher : il saisit discrètement la carte placée au niveau du cœur de l’adolescent et dont le corps gît sous la table où se déroule la partie. A peine posée sur la table de jeu, un tonnerre d’applaudissement retentit : c’est dans un théâtre, au centre de la scène que le poète se tire une nouvelle fois une balle dans la tête. A sa tempe, marquant la blessure, une étoile. Le sang coule, qui inonde ses yeux demeurés ouverts.
Rendre compte du contenu du film n’en épuise pas le sens. Bien au contraire, il demeure à voir, et en tout premier lieu pour ce qu’il permet de saisir et qui demeure dans le champ de l’invisible à savoir ce que Joyce appelle dans son Ulysse « l’inéluctable modalité du visible », c’est-à-dire, le corps lui-même, pris dans l’impossibilité de sa représentation.
Ainsi le sang, et de manière non anecdotique, le sang qui coule, intervient-il à deux reprises dans le film. Dans sa première occurrence, il constitue pour ainsi dire le principe matériel-irréel d’une prise de conscience : les visions déceptives du poète, lorsqu’il se trouve de l’autre côté du miroir, tiennent assurément leur insuffisance d’une sorte de lacune ontologique. Littéralement inclus dans le processus onirique, le sang qui coule alors demeure,en effet, essentiellement marqué par la facticité et l’inconsistance ontologique de ses effets .Effets en l’occurrence inapparents, puisque le rêve ne se déchire pas, puisqu’aucune réalité nouvelle ne surgit du coup de feu. Le sang qui coule n’est alors que l’élément superficiel et pour ainsi dire symbolique d’une accession redondante au statut de poète que le rêveur possédait déjà. Et s’il se trouve alors auréolé d’une couronne de laurier, celle-ci n’opère qu’à la façon d’un déguisement social (dans l’ordre de la reconnaissance publique), et non pas sur le mode d’un révélateur existentiel. L’élément sanguin, réduit à un artefact symbolique n’est plus que l’apparat iconique d’une pseudo-révélation : ne conférant corps à aucune réalité, il est tout au plus l’élément figuratif d’un mensonge – celui que serait tenté de se raconter à soi-même le poète afin de se comporter comme poète. On se souvient en effet que si ce dernier avait pénétré à l’intérieur du miroir, il ne s’agissait pour lui que de répondre à la provocation de la statue : « Tu as prétendu que l’on pouvait traverser les miroirs. A toi de monter que cela est réellement possible ». Cette injonction « réaliste » était un autre leurre : les visions successives à l’intérieur des différentes chambres demeurent lettre morte : elles sont intransposables dans le champ de la matérialité, c’est-à-dire de la vie. Voilà pourquoi les miroirs feraient mieux de réfléchir avant de renvoyer toute image.
Lettre morte. Il s’agit bien en effet de vie et de mort. Le paradoxe du film apparaît alors : certes l’imaginaire (le poète est enclos dans le rêve, il traverse le miroir à la recherche d’images nouvelles qui viendront probablement parcourir son œuvre, nous-mêmes, spectateurs contemplons un ensemble mouvant d’images) constitue ici une condition a priori de notre être-au-monde, ce dernier fût-il chimérique. Mais simultanément est requis pour ces mêmes images leur extraction du domaine purement imaginal. En d’autres termes est posée pour toute image le réquisit de son effectivité dans la vie. A ce titre, formulons ici l’hypothèse d’une réminiscence homérique.
L’image peut-elle tuer ?
Souvenons-nous en effet : au champ XI de L’Odyssée, Ulysse est parvenu, aidé par Circé, à pénétrer avec ses compagnons dans le Royaume des morts. Or les habitants d’Hadès, s’ils ont conservé leur forme humaine, en sont réduits désormais à n’être que des ombres inconsistantes et muettes. C’est ainsi face à ce qui n’est à présent que le fantôme du devin Tirésias, qu’Ulysse verse le sang de plusieurs animaux. Attirés par la vision de ce sang, les ombres se rapprochent alors et Ulysse de raconter :
« Moi, ayant tiré du long de ma cuisse mon épée aiguë, je restais là et j’empêchais les morts, têtes débiles, d’approcher du sang, avant que j’eusse interrogé Tirésias » (Odyssée, chant XI, vers 48-50)
Ce n’est qu’après avoir bu le sang versé, que Tirésias retrouvera une consistance momentanée et pourra, de nouveau dôté de la parole, révéler à Ulysse le destin qui est le sien.
Après avoir écouté Tirésias, Ulysse laisse approcher sa mère, Anticlée :
« Moi je restais là sans bouger, jusqu’au moment où ma mère vint et but le sang noir. Aussitôt elle me reconnut, et, gémissant, m’adressa ces paroles ailées : ‘ Mon enfant, comment es-tu venu vivant sous cette brume ténébreuse ? Il est difficile à des mortels de contempler ce monde. Ils en sont séparés par de grands fleuves et d’effroyables torrents…’ » (ibidem, vers 150-155)
Les « grands fleuves » et les « effroyables torrents » sont devenus dans l’imaginaire poétique de Cocteau un miroir dont la substance aqueuse trouble,plus qu’elle ne révèle, l’enjeu de la création. Il n’en demeure pas moins que dans le texte homérique aussi bien que dans le film, le sang constitue un véritable opérateur de matérialité : c’est à partir de lui, à travers lui, que résonne la voix du monde – voix de l’inspiration pour le poète, voix de l’au-delà pour Ulysse. La figure d’Orphée opère souterrainement dans cet ensemble métaphorique. Orphée qui lui aussi verra son sang couler pour n’avoir pas su ramener Eurydice du fond de l’Hadès… Le vampirisme des habitants de l’Hadès, ou plutôt leur tropisme à l’endroit du sang, est ce qui opère seul le partage des vivants et des morts.
C’est dans ce contexte symbolique que le deuxième suicide du poète prend toute son épaisseur signifiante: il inaugure, à rebours du premier acte suicidaire, non point l’épiphanie d’une nouvelle image inopérante de la mort, mais de la mort elle-même à laquelle le poète consent. La tricherie sémantique dont il s’est rendu coupable (« si tu n’as pas l’as de cœur, tu es un homme mort ») en subtilisant le cœur en forme de carte à jouer de l’adolescent, s’accompagne d’une sanction immédiate : la renonciation volontaire à la vie. Ici, la facticité de la représentation s’abolit dans la réalité morale de l’acte créateur. Le sang qui coule alors sur les yeux demeurés grand ouverts du poète ne constitue plus seulement un nouvel artefact visuel. Il est le signe distinctif de la densité ontologique de tout acte créateur. De fait,il ne s’agit plus de « parler pour ne rien dire » ou ne rien faire, en s’abandonnant au pur plaisir des mots. Il s’agit tout au contraire de produire, à partir de son propre corps, dans la matérialité incontournable de sa chair vibrante, le vocable qui transformera toute vie, à commencer par celle de l’auteur. Le sang d’un poète est ainsi un film sur l’engagement créateur : film-texte qui se propose d’utiliser l’image à revers pour en sortir, et atteindre ainsi au centre de la vie « réelle ». Dans ce mouvement centripète de l’imago sanguin se joue le sens même de toute image en tant que sur elle pèse le lourd soupçon d’irréalité .
Comme le fait remarquer Marie-Josée Mondzain dans son essai intitulé L’image peut-elle tuer ?, il faut distinguer l’image de l’idole. Là où l’image suscite le désir en ménageant une distance entre ce qui est dévoilé et ce qui caché, et constitue par là un appel vers l’invisible, l’idole au contraire « vampirise » le regard et opère comme une substance à laquelle il faudrait nécessairement s’identifier. A la lumière de cette analyse, il serait alors possible de conférer à l’imago sanguin la portée non d’un symbole comminatoire ordonnant l’abandon de soi à l’irréalité captivante de l’image, mais celle au contraire d’un réquisit réaliste. En d’autres termes, là où le sang ne coule pas, l’image est morte et demeure dans la transparence miroitante et confuse de son auto-référence. Il faut donc que le sang coule, pour que le monde réel se reforme et s’informe, (au sens littéral de « se voir imprimer une forme par une force externe ») : partant, l’image poétique deviendra monde sous l’effet de cette nouvelle rigueur ontologique.
***
Le film est visible sur Youtube.
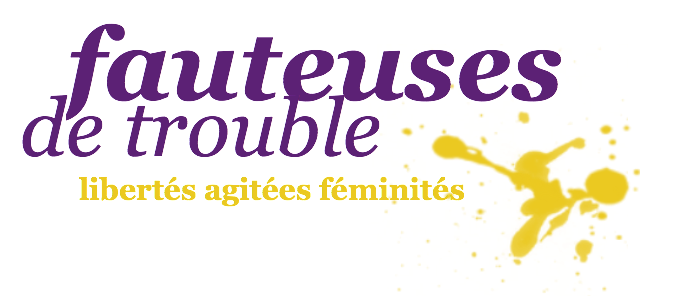



Commentaires récents