« Rares sont les gitans qui acceptent d’être tenus pour pauvres, et nombreux pourtant sont ceux qui le sont. Ainsi en allait-il des fils de la vieille Angéline. Ils ne possédaient que leur caravane et leur sang. Mais c’était un sang jeune qui flambait sous la peau, un flux pourpre de vitalité qui avait séduit les femmes et engendré sans compter. Aussi, comme leur mère qui avait connu le temps des chevaux et des roulottes, ils auraient craché par terre à l’idée d’être plaints. »

"The gypsy caravan" de Thomas Corsan Morton
Voilà comment commence Grâce et dénuement, le roman écrit par Alice Ferney en 1997, qui a reçu le prix Culture et Bibliothèque pour tous la même année. Une écriture simple et sincère, qui nous propulse dès les premières pages au milieu de l’histoire d’une famille attachante et pourtant parfois dérangeante, qui nous touche et nous choque, nous donne envie de rire, de pleurer, d’espérer, de questionner, de douter.
Les hommes sont fiers, les femmes sont belles, les enfants chamailleurs, vifs, et insolents.
Dans ce campement, le temps semble avoir suspendu son cours, la vie telle que nous la connaissons paraît bien loin. Comme des observateurs silencieux, on avance au milieu des caravanes, près du feu qui brûle le jour entier, alimenté par tout ce qui passe par la main de « la vieille ». Angéline veille sur ses cinq fils, ses quatre belles-filles, et ses huit petits-enfants. Dans cette histoire, les hommes sont fiers, les femmes sont belles, les enfants chamailleurs, vifs, et insolents. La vie se passe dehors, jamais très loin de ce feu, sauf quand les hommes vont faire leur « tournée », en espérant ramener un quelconque butin pour impressionner leurs femmes. Cette vie en communauté empêche la moindre intimité, et pourtant ici aussi on ferme les yeux sur ce qui se passe dans la caravane voisine une fois les rideaux tirés, ici aussi le silence prend parfois toute la place.
Les hommes sont fiers, restent à l’écart des femmes, qui sont pourtant leur principal sujet de conversation.
« Les hommes étaient détruits, bien plus que les femmes (sans doute parce qu’elles portaient les enfants et qu’elles étaient occupées à les aimer, les nourrir, les laver et les battre, ce qui suffit à faire une vie). Ils étaient défaits parce qu’ils n’étaient obligés à rien. Ils n’étaient jamais tendus vers quelque chose, personne n’attendait rien d’eux. (…) Ils n’aidaient pas à ce qui reste aussi longtemps que l’on ne meurt pas : l’intendance de la vie. Ils étaient entrés dans le grand bavardage masculin, cette manière égoïste de se tenir sur la terre, de vivre dans les jupes des femmes, suspendus à toutes leurs lèvres, réclamant le nid, l’amour et la becquée, dans le même élan obstiné qui le soir les portait à ce martèlement, la forme harcelante, haletante et suante, que prenait leur désir ».
Et en effet, très vite, on se rend compte que ce sont les femmes qui font tourner le campement, et que le rôle des hommes se limitent souvent à une bonne dose d’autoritarisme et de machisme clairement assuré. On est pourtant touché par l’amour de Lulu pour sa belle et triste Misia. « Tu es belle, murmura Lulu, qui était bouleversé quand Misia avait du désir. Il tenait les fesses de sa femme dans ses mains, leur parfaite consistance (un peu de mollesse charnue et le velouté de cette peau qui ne voyait jamais le soleil) le rendait fiévreux ». On est touché aussi par les amours et les rêves interdits d’Angelo, l’aîné resté célibataire. On est touché par le destin de ces hommes qui se savent inutiles sans pouvoir le reconnaître, parce qu’alors à quoi bon continuer…
Alice Ferney ne juge pas, n’enjolive pas.
 On est fasciné par Angéline, cette grand-mère aux dents noires mais au rire franc, qui tient sa tribu d’un oeil attentif, souvent bienveillant, parfois cruel, mais toujours vif. Une vieille dame assagie par les épreuves passées, la perte d’un mari, la recherche perpétuelle d’un terrain où ils pourraient enfin s’installer sans crainte d’une expulsion. Une femme qui a compris que finalement, la seule chose qui importe, c’est l’amour, parce que « qu’est-ce qu’on avait d’autre dans la vie que se caresser pour le plaisir, se disputer pour le soulagement et s’endormir pour l’oubli ? ».
On est fasciné par Angéline, cette grand-mère aux dents noires mais au rire franc, qui tient sa tribu d’un oeil attentif, souvent bienveillant, parfois cruel, mais toujours vif. Une vieille dame assagie par les épreuves passées, la perte d’un mari, la recherche perpétuelle d’un terrain où ils pourraient enfin s’installer sans crainte d’une expulsion. Une femme qui a compris que finalement, la seule chose qui importe, c’est l’amour, parce que « qu’est-ce qu’on avait d’autre dans la vie que se caresser pour le plaisir, se disputer pour le soulagement et s’endormir pour l’oubli ? ».
Alice Ferney ne juge pas, n’enjolive pas. Angéline non plus quand elle parle de son fils Simon, « le fou » : « je l’ai su dès qu’il était petit qu’il était pas comme les autres. Il était câlin et en même temps, dès qu’il a eu la force, il a cassé tout ce qu’on lui donnait. Sa première femme, il l’a cassée ». Mais parfois, elle ferme les yeux, croyant ainsi protéger ses enfants d’une réalité pourtant bien visible.
« Elle lut comme jamais elle ne l’avait fait, même pour ses garçons : elle lut comme si cela pouvait tout changer. »
Après une année de visites hebdomadaires, Angéline accepte qu’Esther, une ancienne infirmière devenue bibliothècaire, vienne faire la lecture aux enfants du clan.
« Elle lut comme jamais elle ne l’avait fait, même pour ses garçons : elle lut comme si cela pouvait tout changer ». Une sorte de magie s’installe autour de ces moments de lecture du mercredi matin, on aimerait y être pour voir la tête de tous ces marmots soudainement passionnés. L’hiver, ils s’installent tous dans la voiture d’Esther, avec le moteur qui tourne, pour profiter du chauffage. « Esther ne s’arrêtait plus de lire pendant près d’une heure, et quand elle finissait, ils s’étiraient, revenant de l’autre monde, plus enveloppant, plus rond, plus chaud que celui dans lequel ils retournaient à peine sortis de la voiture et qui les mordait au visage comme un chien fou ».
Esther est convaincue que les livres sont nécessaires, « comme le gîte et le couvert », et, force tranquille, mais décidée, elle avance à pas feutrés dans ce campement, et offre son aide, son envie, son art. Et elle nous entraine avec elle dans cette mission littéraire, et bien au-delà, jusque derrière les rideaux baissés des caravanes, jusqu’au coeur d’Angéline.
Grâce et dénuement a déjà été critiqué comme étant bien-pensant, un peu niais ou trop convenu. Peut-être aurait-elle pu enlever quelques petites phrases qui pourraient paraître un peu sentencieuses, voire un peu cucul, mais pour le reste, derrière une écriture assez classique se cache un roman moderne et percutant, qui fait réfléchir, beaucoup, et qui serre le ventre, souvent. Un mélange d’optimisme forcené et de désespoir fataliste qui vous prend à la gorge et ne vous lâche pas jusqu’à la dernière ligne.
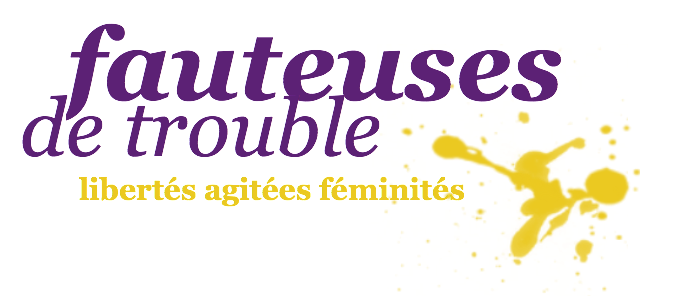


La compagnie Nantaise « Théatre d’ici ou d’ailleurs » en a fait un magnifique spectacle: « Gadji! » avec des chants tziganes particulièrement émouvants.