 La musique est une affaire de cœur tout autant que d’oreille(s). Avec certains albums, c’est le coup de foudre, celui qui nous fusille sur place et nous fait dire : « Parce que c’était lui, parce que c’était moi ». Comme une évidence. Et puis, il y a les autres. Ces albums qui nous plaisent à la première rencontre, sans nous faire chavirer pour autant. Il y a bien quelque chose qui accroche notre attention, une chanson qui n’en finit plus de nous trotter dans la tête, une atmosphère intéressante… en somme, un je-ne-sais-quoi qui nous fait dire : « Sympa, j’y reviendrai ». On met l’album de côté, et puis on attend. Mais on attend quoi, au juste ? Tout simplement que l’envie nous prenne de le revisiter. Il y a des albums qui ne nous rencontrent pas tout de suite ; peut-être qu’ils ne nous rencontreront jamais. Les voies de la musique sont impénétrables.
La musique est une affaire de cœur tout autant que d’oreille(s). Avec certains albums, c’est le coup de foudre, celui qui nous fusille sur place et nous fait dire : « Parce que c’était lui, parce que c’était moi ». Comme une évidence. Et puis, il y a les autres. Ces albums qui nous plaisent à la première rencontre, sans nous faire chavirer pour autant. Il y a bien quelque chose qui accroche notre attention, une chanson qui n’en finit plus de nous trotter dans la tête, une atmosphère intéressante… en somme, un je-ne-sais-quoi qui nous fait dire : « Sympa, j’y reviendrai ». On met l’album de côté, et puis on attend. Mais on attend quoi, au juste ? Tout simplement que l’envie nous prenne de le revisiter. Il y a des albums qui ne nous rencontrent pas tout de suite ; peut-être qu’ils ne nous rencontreront jamais. Les voies de la musique sont impénétrables.
Rome (2011) avait tout pour tomber dans la catégorie « coup de foudre », des artistes derrière le projet à la thématique du western spaghetti, en passant par les deux premières chansons que Danger Mouse et Daniele Luppi ont fait filtrer : « Black » (feat. Norah Jones) et « Two Against One » (feat. Jack White). La première était entêtante, ensorcelante ; la seconde électrisante, stupéfiante. Et puis, au moment de l’écoute de l’album entier, la claque s’estompe pour laisser place au fameux : « Sympa, j’y reviendrai ». La première rencontre se révèle un peu décevante au final, mais « Black » et « Two Against One » restent là, s’installent en nous. Ils s’assurent que l’on garde Rome dans un coin de la tête, une destination musicale qui n’attend que nous. Patiemment. Avec la même patience qu’il aura fallu à Danger Mouse et Daniele Luppi pour que leur hommage aux bandes-son des westerns spaghettis voie le jour, au bout de cinq ans de collaboration, trois voyages à Rome et quelques jours passés à sillonner les routes à la recherche de vieux instruments pour l’enregistrement.
Je n’ai pas mis cinq ans pour revisiter cet album, mais notre vraie rencontre s’est faite sur la route. Un long voyage se profilait, aucun de mes classiques ne m’inspirait, et puis mes yeux se sont posés sur cet album, et le déclic s’est fait. Tiens, si j’y revenais ? Un pourquoi pas qui est devenu une évidence à la première réécoute. J’avais enfin la clé de cet album : Rome était fait pour la route. Il prend tout son sens quand l’auditeur est en mouvement, déplacé, déconnecté de tout ou en partie, plongé dans une attente tout en connaissant sa destination. Quand on revisite un album, c’est la même chose : on connaît la destination, mais on ne sait pas quel(s) chemin(s) la musique va nous faire emprunter cette fois. Ce qu’elle va nous évoquer, ce qu’elle va rencontrer en nous, impossible de le prédire à l’avance.

Voyager nous plonge dans une atmosphère particulière, surtout quand on voyage seul. Une atmosphère un peu douce-amère, qui nous entraîne tour à tour vers le passé, le futur et le présent. C’est cette atmosphère que l’on retrouve nichée au cœur de Rome. Daniele Luppi le dit lui-même : l’album ne raconte pas une histoire, il retranscrit une ambiance (brumeuse et mélancolique, selon ses mots) qui explore les grandes thématiques (la vie, la mort, le bonheur, le désespoir…) et la connexion viscérale entre l’homme et la femme (encore ses mots). Un homme et une femme, justement, prêtent leurs voix au projet : Jack White et Norah Jones.
Tous deux amènent avec eux leurs univers distincts et distinctifs et les mettent au service de Danger Mouse et Daniele Luppi. Jack White prête aussi sa plume : c’est lui qui a écrit les paroles des trois chansons sur lesquelles il chante. Ces paroles lui sont venues sur la route, en écoutant les morceaux instrumentaux dans sa voiture. On y retrouve des thématiques typiques de White (l’individu seul face aux autres, une tendance à l’autodestruction, ou encore la présence récurrente de la lune) qui se fondent à merveille avec l’ambiance générale de Rome. Le personnage solitaire et meurtri de « The Rose with the Broken Neck » évolue dans un décor digne de Sergio Leone, avec sa ferme, sa voie ferrée, ses corbeaux aux cris plaintifs et ses chiens qui gémissent au loin. Celui de « Two Against One » livre la bataille ultime, qui l’oppose à un(e) autre, mais surtout à lui-même : « I get the feeling that it’s two against one / I’m already fighting me, so what’s another one ? ». L’arme qui blesse réside autant dans la bouche de l’autre que dans le regard que l’on porte sur soi-même : « The mirror is a trigger and your mouth’s a gun », « It’s just you and me against me ». La présence de Jack White permet à l’album d’explorer la dimension brûlante, étouffante et torturée des westerns spaghettis.
Si White souffle le chaud, Norah Jones, elle, vient souffler le froid. C’est d’ailleurs White qui a pensé à elle pour la voix féminine de l’album ; il se disait qu’elle apporterait un contraste intéressant à sa voix à lui. Il a vu juste : White et Jones sont le yin et le yang de Rome. Jones vient tempérer les accès torturés de la voix de White et fait preuve d’un cynisme délicieux, rafraîchissant. Elle aussi parle de ses blessures, ses plaies qui n’arrivent pas à se refermer. « Problem Queen » met en scène une autre figure solitaire, en état de choc, qui se fait malmener par la vie au point de se sentir désincarnée, déconnectée d’elle-même : « And it seems I’m a dream », « Can’t see through this hazy view / And all the doors are locked ». Mais le ton distant qu’elle décide d’adopter est une première victoire contre tout sentiment de fatalité, un sentiment que combat « Season’s Trees ». Le problème n’est pas de devoir affronter la dure réalité (« Every girl gets her dreams / Cast into reality / Never seemed to bother me / Only just recently »), mais de se cogner au défaitisme généralisé : « ‘Cos you seem to behave / Like we’ll always be slaves / Never running away / Can’t we be / Like the season’s trees / Changeably / Just not too easily ». Le monde décrit dans « Black » a beau être noir d’encre, c’est aussi un lieu étrangement reposant (« Where the last pain is gone and all that’s left is black »), car les masques tombent (« It’s not a mask, so be honest with me »), révélant tout sauf des anges : « To the church no intent to repent / On my knees, just to cry », « They can’t afford to ignore that I’m a disease ». Le voyageur solitaire, exténué, peut enfin s’allonger et contempler la noirceur du ciel et la noirceur en lui, sans états d’âme, en simple observateur.

D’après Rome, le monde est une affaire de mouvement perpétuel : « The world is a running brook / Take a look / Cold and always moving / Blind but never soothing ». Derrière sa cruauté apparente, ce n’est pourtant pas lui qui nous malmène. Chacun porte en soi son meilleur ennemi (« Welcome to your own abuse / Your greed is your own hangman’s noose »), cette voix qui ne cesse de nous interpeler dans le miroir de « Two Against One ». Parce que le monde est en mouvement perpétuel, cela ne sert à rien de chercher à le contrôler (« The world is a bull whose horns you cannot pull »). Il y a quelque chose de libérateur dans cette prise de conscience douce-amère, qui fait écho à ce sentiment de liberté souvent teinté de mélancolie que l’on peut éprouver sur la route.
La route et Rome ne font décidément qu’un. Ce qui n’est pas vraiment surprenant, quand on y pense : tous les chemins mènent à Rome.
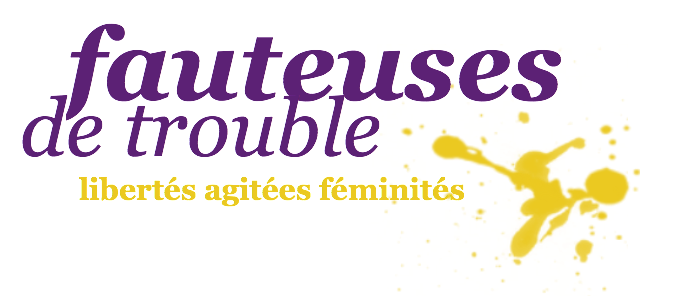


Commentaires récents