Voyage dans l’Arkansas de Pierre Mérot
Un jour, durant l’été, je n’ai plus vraiment eu envie de lire, j’ai eu envie de relire. J’ai eu envie d’aller vers un de ces livres qui m’attendaient patiemment, dans la bibliothèque, tout près, à portée de main, un de ces livres capables de donner du sens aux journées les plus vides. Ces livres, on ne les oublie pas, même si les détails s’effacent au fil des jours et des années. On se souvient même de la première lecture, de ce qui nous entourait et qui semblait avoir été créé juste pour nous entourer. J’ai refermé Arkansas de Pierre Mérot il y a plusieurs étés, perdu entre quelques montagnes, au bord d’un minuscule cours d’eau. Autour de moi, quelque chose de bien plus grand que moi me disait que tout n’était peut-être pas vain. Dans mes mains, un livre bien plus grand que moi me disait que tout n’était peut-être pas vain. De quoi donner envie de le relire quelques années plus tard.
Houellebecq et Kurtz
Mais que trouve-t-on, au juste, dans Arkansas ?
On pense tout d’abord y croiser Michel Houellebecq. Le roman, dès sa publication en 2008, doit une partie de sa promotion à un petit jeu de masques. Pierre Mérot, ami de Michel Houellebecq avant que ce dernier ne devienne la star qu’il est toujours, nous présente dans ce roman François Court, plus connu sous le nom de Kurtz. Kurtz est un écrivain adulé et désespéré, dont on pourrait résumer la vision du monde en quelques mots : il n’y a rien. Le roman ne cherche pas à maquiller les traits de Michel Houellebecq, comme l’indiquent ces retrouvailles entre Kurtz et Traum, l’autre grand écrivain du roman. Les deux hommes, après avoir été longtemps amis, se sont perdus et se retrouvent un soir, dans un restaurant :
« La pluie avait cessé. Il faisait frais. Nous avons bu des cocktails à base de rhum. Kurtz est devenu plus bavard. Il a parlé de Jacques Dutronc et de Françoise Hardy. Il était leur ami. Il côtoyait la plupart des gens célèbres. Je les regardais. Il s’habillait mieux qu’autrefois. Il portait des vêtements de marque. Il avait renoncé aux anoraks puérils, aux vestes fripées, aux chemises à carreaux achetées chez Monoprix. Il fréquentait des coiffeurs à la mode. Ses rares cheveux, jadis filasses, étaient devenus d’un blond doré. […] Il n’y a rien de pire que d’avoir été l’ami d’un homme ordinaire devenu célèbre. Mais quand même, Kurtz a l’art de construire sa légende en trahissant et en rendant publiques ses trahisons… Qu’importe !… La conversation s’empara ensuite des choses sexuelles. François Court, Kurtz-Le-Mal-Doté, avait multiplié les expériences. Le porte-parole de la misère occidentale s’était finalement tapé la terre entière. Qu’ils fussent jeunes ou vieux, les corps étaient pour lui équivalents. Il en parlait d’un ton blasé. Encore une fois, je n’ai pas beaucoup de souvenirs. A un moment, j’ignore comment cela est venu, il m’a regardé fixement et a répété avec insistance : « une négresse prise par tous les orifices ! PRISE PAR TOUS LES ORIFICES ! » En fait, je crois qu’il était question de la suite de la soirée. Nous avions beaucoup bu. Mais moi, âme restreinte et fatiguée, je n’avais nulle envie de poursuivre. »
Françoise Hardy, les anoraks, Monoprix, le ton blasé, la misère sexuelle et le cynisme sous toutes ses formes, même les plus détestables : tout y est. Difficile de ne pas voir en Kurtz l’avatar de l’icône médiatique qu’est peu à peu devenu Houellebecq. Et pourtant, l’intérêt du roman n’est pas là. Il n’est pas dans ce qu’emprunte Pierre Mérot à la réalité, mais plutôt dans ce qu’il imagine. Car le destin de Kurtz ne sera pas celui de Houellebecq, en tout cas on l’espère. Dans le roman de Pierre Mérot, Kurtz décide un beau jour, pour des raisons un peu obscures, d’investir un étrange site espagnol baptisé « Arkansas ». Il le rénove puis il y réunit des admirateurs : peoples et anonymes se rassemblent ainsi autour du maître et de sa nouvelle utopie. Peu à peu, Kurtz invente pour ses fidèles des ateliers, des cérémonies, des cultes étranges. Antoine Baragouin, sorte de secrétaire particulier de Traum, nous raconte ainsi l’arrivée et l’initiation de Rita, la grande Rita dont il nous faudra reparler, celle qui donnera un fils à Kurtz :
« Autour de Rita s’étendaient des barbelés, des baraquements blancs, un bâtiment circulaire, des buissons sporadiques, deux ou trois piscines à moitié remplies, un vague jacuzzi peinturluré et de vieux corps gélatineux. On se serait cru dans un camping naturiste au bord d’une Baltique surchauffée !… […]
On baptisa Rita triplement, selon le rite d’Arkansas : dans le lac –ou était-ce une misérable tourbière ?- dans la piscine centrale, et dans la cuve régénérante. Les élus formaient un cercle cosmique. Kurtz entièrement nu, était orné du fameux collier harmonieux. Rita prononça après lui les formules suivantes : « je me voue à l’Eau Radieuse et à la communauté », « Je crois en l’immortalité procurée par la science », « je suis l’épouse du Fils-De-La-Lumière. Je lui obéis quoi qu’il demande. Et je chante ses œuvres trois fois dans la journée ». (En effet, précisai-je sur la terrasse, les élus se relayaient pour lire les ouvrages de Kurtz à des heures précises, lectures évidemment diffusées par les haut-parleurs du camp.) A la fin de chaque phrase, Rita jetait quand même un tonitruant Boje moi ! bien à elle. Puis le Fils-De-La-Lumière posa une gélule bleue sur sa langue. Et dans les remous du maigre jacuzzi, il la pénétra en fermant les yeux, tandis que les élus entonnaient l’Ode à la Joie. »
Comme chacun peut le constater ici, tout ne tourne pas rond dans Arkansas. On se gardera bien de dévoiler la fin de ce cirque mais on peut vous annoncer que l’utopie vaguement cinglée et franchement comique va peu à peu s’assombrir. Jusqu’à donner quelque chose entre les Cent Vingt Journées de Sodome et American Psycho. Rien que ça
On est donc loin du véritable Michel Houellebecq. Kurtz n’est pas un double du dernier lauréat du prix Goncourt, ou pas seulement. C’est un personnage dont les racines plongent certes dans l’auteur d’extension du domaine de la lutte mais qui va plus loin que Houellebecq ne le fera jamais.
Pierre Mérot n’a donc pas écrit une biographie déguisée de Houellebecq, pas même un pamphlet visant à régler quelques comptes avec celui qui était son ami. Il a simplement utilisé l’image médiatique de Houellebecq pour la maquiller et la transformer. Le miroir d’Arkansas est bien un miroir déformant, c’est un miroir littéraire.
Traum et Baragouin
Mais Kurtz a dans le roman une autre fonction. Il sert de contre-point à Traum. Ecrivain talentueux mais plus confidentiel, Traum a choisi d’emprunter, dans les vastes terres de ce qu’on appelle Littérature, un chemin opposé à celui de Kurtz. Quand Kurtz a choisi le réalisme, Traum a pris le parti de l’irréalisme. Difficile, ici, de ne pas lier Traum à Pierre Mérot, auteur, en 2005 d’un roman justement intitulé L’irréaliste. Mais, puisque Kurtz n’est pas vraiment Houellebecq, on se gardera bien d’affirmer que Traum est Pierre Mérot.
Traum est un doux rêveur, qui passe l’essentiel de son temps à boire et à parler. Sa parole, sa riche et emphatique parole, est recueillie par Baragouin, un jeune sdf alcoolique et cultivé qu’il a accueilli dans son modeste appartement et qui est devenu son secrétaire particulier. Le véritable narrateur d’Arkansas est donc Baragouin, même si, à travers lui, par ses écrits ou ses longs discours, c’est souvent Traum qui prend la parole. Les deux hommes forment donc un duo important et inséparable. La voix de Baragouin, d’abord timide et effacée, prend peu à peu de l’assurance. Il va même, en définitive, jusqu’à prendre la place de Traum, si bien qu’on en vient à se demander si, par la grâce de l’irréalisme si cher à Traum, les deux hommes ne forment pas qu’une seule et même personne. Et leur parole est éclatante, presque ampoulée.
Leur style s’oppose ainsi à celui de Kurtz. Ce dernier semble adepte des phrases courtes, de l’ironie et des nombreuses figures de style d’atténuation. Traum, et après lui Baragouin, font eux le choix de la démesure. Qu’on se penche, par exemple, sur cette admirable interrogation, qui défie à la fois les lois de la syntaxe et celles de la respiration.
« Alors, dis-je, moi, dis-je, selon la formule rituelle, alors, demandai-je à Traum, là-haut, sur la terrasse irréaliste, loin du monde, si loin de la réalité si simple du monde, où ça donc, là-bas, là-bas, sous un ciel d’automne, sous l’automne revenu, sous l’automne des inventeurs d’histoire, alors, dis-je, sans remords, sans aucune dette contractée avec le réel, uniquement pour la jubilation, uniquement pour la jubilation, la complexe jubilation, la jubilation complexe, et peut-être impartageable, d’UNE AUTRE DIMENSION, et je ne savais plus trop ce que je disais, mais Traum me regardait avec des yeux de forceps, avec des yeux magnifiquement clairs, compréhensifs et jouisseurs, alors donc, dis-je, et demandai-je, et déclarai-je, sans souci de simplicité, sans besoin de logique, aveugle sous les nuages de novembre, cherchant je ne sais quel regard prodigieux, vous prétendez, finis-je par prononcer, et les mots me sortaient de la bouche, sans honte, crapauds ou diamants, qu’importe ! alors, alors, grésillai-je, chantai-je, murmurai-je, comme un enfant au pied du sapin, prisonnier des éclats puérils de la neige, et comme celui qui, n’importe qui, quiconque se refuse à mourir, alors, dis-je, et j’aurais pu continuer longtemps, mille et une nuits, oui, mille et une nuits, certainement, j’aurais pu certainement, indéfiniment, mû par l’envie humaine, la miséreuse envie de retarder la mort, j’aurais pu, oui, éternellement, différer ma question, alors vous prétendez que Kurtz commençait à sombrer dans une sorte de démence ??? »
Dans de tels morceaux d’anthologie, la langue ne marche plus, elle danse, elle titube et chante comme un buveur heureux qui passerait éternellement d’un bar à l’autre. Pierre Mérot nous fait ici remonter le cours du temps. Car c’est Rabelais qui nous parle parfois dans ce roman. Ce sont aussi les écrivains baroques qu’on croit entendre, avec leurs phrases libres et éclatantes.
Lors de la publication de Mammifères, Pierre Mérot a beaucoup été comparé à Houellebecq. A juste titre, on voyait chez eux un même regard impitoyable et cinglant. Mais c’était oublier les envolées lyriques du narrateur de Mammifères, un lyrisme que n’atteint pas un Houellebecq plus occupé à désenchanter. Lisons donc la fin, l’admirable fin de Mammifères :
« Pourtant, il vous arrive d’être heureux. Vous mourrez peut être précocement d’une cirrhose, d’une overdose ou d’un abus quelconque, mais vous n’aurez pas ressemblé à une famille étroite et à tous ceux qui veulent vous empêcher de vivre. C’est un soir de juin, le ciel est bleu et rose. Vous descendez la rue, votre rue, avec votre liberté, même si elle est maigre et insatisfaisante. C’est vous qui l’avez conquise, et contre ceux qui vous paraissaient invincibles. Les enseignes lumineuses palpitent, les immeubles sont là, c’est toute la vie, et elle est entièrement disponible. Vous n’avez jamais contraint personne ni méprisé au nom de valeurs stupides et mortifères. Vous êtes vivant. Vous regardez les immeubles légèrement roses. Un jour, vous ne les verrez plus. Mais aujourd’hui, c’est à vous et à vous seul, qu’il est accordé de voir ce trésor extravagant et provisoire, et personne ne peut prétendre être à votre place.
La rue est une rivière d’aventures urbaines. L’air est chaud et fraternel. Le monde n’est pas complètement un ennemi. Des voisins vous tapent sur l’épaule. Les patrons des cafés vous saluent : « Alors, l’oncle ! on te voit ce soir ? » Bien sûr, bien sûr ! Ce soir, vous irez finir ce livre dans tous les bars du monde, sur les comptoirs rayonnants, sans penser à l’amour, dans la gueule fardée de l’alcool. Boire, aimer ou vivre, quelle différence ? C’est une même saloperie somptueuse. Vous aurez un vague sourire, celui que la forme du verre finit par creuser dans les verres.
Vous irez, dur comme l’époque, avec un cœur amnésique et souple, libre de toute précaution morale, parmi les corps masturbés de lumière qui se heurtent et s’oublient. Les dîneurs rient. Les téléphones sonnent. Derrières les rires, rien ne va plus. L’amour se fait et se défait comme à la Bourse. L’époque est médiocre. Plus l’époque est médiocre, plus l’insatisfaction est immense. Des cœurs solitaires battent en silence côte à côte, dans une colère contenue ou encore inconsciente. L’éclatement est proche. »
Alors qu’il constate lui aussi que tout s’effondre, que l’époque est dure, que les crapules triomphent, que le monde semble triste à en pleurer, Pierre Mérot ne se résigne pas tout à fait. Il chante la beauté du monde, la douceur des plaisirs, plaisirs de l’amour, parfois, de l’alcool, souvent. Il chante tous ces trésors « extravagant(s) et provisoire(s) ». Dans Arkansas, les voix de Traum et de Baragouin se mêlent dans un chant qui nous raconte la folie du monde et la douceur de vivre. C’est dans cette réconciliation en apparence compromise que tient toute l’œuvre de Pierre Mérot.
Mais on ne peut pas, on ne veut pas en rester là. Folie et douceur, extravagance et grandeur… Ces mots appellent deux personnages qui voudraient nous dire quelques mots.
Rita et M. Bach
Car comment oublier la grande, la trébuchante, la gracieuse, l’assoiffée, la très slave, la radieuse, la ténébreuse et orageuse Rita ?
On la découvre un soir, dans la rue, dès le tout premier chapitre du roman. Elle pousse un misérable landau. De son appartement, Traum finit par la remarquer car trois créatures, Vladimir, Barnabé et le jeune Gaby, sont mystérieusement apparues pour lui suggérer de s’intéresser à cette étrange jeune femme. S’agit-il d’un songe ? Est-ce une affabulation, comme semble le penser Baragouin ? Est-ce le délire de Traum l’alcoolique ? Est-ce une sublime envolée irréaliste ? Comment le savoir ? Et pourquoi le savoir ? Au fond, peu importe. C’est donc ainsi qu’apparaît Rita : « ainsi commencèrent les choses par la nuit dénuée de bleu, la nuit miséreuse et folle abattue sur Paris ».
Orpheline née en Russie, prostituée dès son plus jeune âge, Rita aurait pu être un personnage de Zola, une jeune femme vouée à une vie et une mort misérables. Mais Pierre Mérot en a voulu autrement car Rita elle-même en a voulu autrement. Par son inépuisable énergie, par son verbe sautillant, par sa syntaxe boitillante, ses jurons et son fameux « Boje Moi ! »[1] qui ponctue nombre de ses phrases, par ses envies débordantes, ses colères et ses rires, Rita nous emporte loin, très loin de la médiocrité qui l’entoure. Elle illumine la vie de Traum qui va l’installer dans sa petite maison de Normandie, dans la petite commune de Bourvil-Sur-Mer. Bourvil-Sur-Mer, commune misérable et laide qui, tout à la fois, attriste et enthousiasme Rita :
« Ainsi allèrent-ils, malgré la médiocrité des lieux, malgré les âges dissemblables, bancals et guillerets, sous un flacon d’iode déversé. Etrange était Rita, aussi changeante que la masse accélérée des nuages. La plage était merveilleusement déserte. Elle posa le panier et se déchaussa. Elle courut sur les algues grasses et le coquilles craquantes. Elle s’agenouilla et gueula : « Boje moi ! Il y a si longtemps que je n’ai pas vue la foutue mer ! Regarde papi, comme c’est beau ! Si tu savais ce que j’ai vécu ! Si tu savais !… » Dans le bol des mains elle soulevait l’eau et la versait fumante sur ses yeux. Et puis elle se tournait vers Traum, joyeuse et désemparée : « Papi, je suis si heureuse, là, maintenant ! Mais demain ?! J’AI LA CHOSE ET LE CONTRAIRE ! Boje moi ! Viens t’enduire avec moi ! » Traum la regardait sauter dans les vaguelettes. Elle était énergique et maladroite. Il souriait. »
« Etrange était Rita »… On le voit, Rita entraine et fascine les hommes qu’elle croise. Traum, Baragouin, mais aussi Kurtz, qui l’a même amenée à ses côtés dans le camp d’Arkansas. C’est d’ailleurs là qu’est conçu Julien, fils de Rita et Kurtz, enfant génial, parfait équilibre de la nature, qui sera destiné à accomplir de grandes choses. C’est ce bébé qu’emmène Rita dans son landau quand Traum la repère et la recueille. Alors que Kurtz allait lui faire subir un avortement des plus sauvages, Rita a réussi à fuir Arkansas et à rejoindre la France. Dans un monde terne et ennuyeux, elle incarne la vie. Sans le vouloir vraiment, elle sauve quelques hommes de l’ennui et les élève, comme un autre personnage du roman : Monsieur Bach.
Ah ! M. Bach… C’est peu dire qu’on sent dans ce roman l’admiration de l’auteur pour la musique de Bach. Il lui dédie Arkansas et il en fait même un personnage aussi vivant que tous les autres. Ainsi, par un miracle qu’on vous laisse découvrir, Traum, vieil écrivain né dans le sombre XXème siècle, va rencontrer son « IDOLE », cet homme qui, par sa musique l’a souvent consolé.
« Tout au long de sa vie, il avait été soutenu par elle, vivifié, glorifié, et, en définitive, construit. Pourtant ce n’étaient que des notes. Au sens propre elles ne disaient rien. Traum cherchait dans sa tête un mot qui pût convenir. Plusieurs se présentaient : puissance, rectitude, joie, désespoir, intelligence, implacabilité, doute, certitude, foi, quotidienneté, et ainsi de suite. Ces mots, et bien d’autres, résumaient sans doute Monsieur Bach. Mais finalement, Traum, au pied de la tribune, tel un vermisseau extasié, pensait à la MAJESTE. Oui, finalement, Monsieur Bach parlait de la majesté, de l’imposante et complexe majesté des vermisseaux. »
Rita et Monsieur Bach, si différents par leur vie et leur œuvre, par la trace qu’il laisse chez les autres personnages, ont pourtant ceci en commun : ils apportent à l’homme un peu de majesté, une majesté entrainante et enivrante.
Alors que vous regardez votre écran, que vous lisez ces lignes, vous avez peut-être l’impression de tout savoir, à présent, sur Kurtz, Traum, Baragouin, Rita ou encore Monsieur Bach. Bien entendu, c’est faux. Au fond, croyez-moi, vous ne savez encore rien d’eux. Il vous reste beaucoup de situations hilarantes ou terribles à découvrir, et beaucoup de phrases à savourer. Des adverbes délicieusement improbables, des suites infinies, gracieuses, savoureuses et malicieuses d’adjectifs qualificatifs, des imparfaits du subjonctif, à la fois charmants et désuets, toute une langue éclatante et profondément vivante. De quoi donner envie de lire, et de relire. Il vous reste à faire un voyage dans un autre monde, si proche du nôtre, et pourtant si différent : « Oui, hors du temps douloureux et inhumain dans lequel il avait vécu ! Parqué dans une ville salle, polluée, incivile, violente, malheureuse ! Dieu merci il avait eu la chance de s’en échapper ! D’échapper à ce réel-là, finalement ! On le lui avait reproché d’ailleurs ! On lui avait reproché son IRREALISME, en effet ! Mais qu’importe ! Car, continuait-il à pérorer, qu’est-ce que la réalité sinon une fiction qui a réussi, à laquelle on nous force à croire comme à un dogme étouffant ?! »
[1] Transcription phonétique et magnifiquement hasardeuse des paroles de Rita par Traum. Baragouin tente de corriger ce dernier, en vain : « Je me permis de signaler à Traum qu’on prononçait Boyé Moye », et que cela signifiait […] « Mon Dieu ! » »
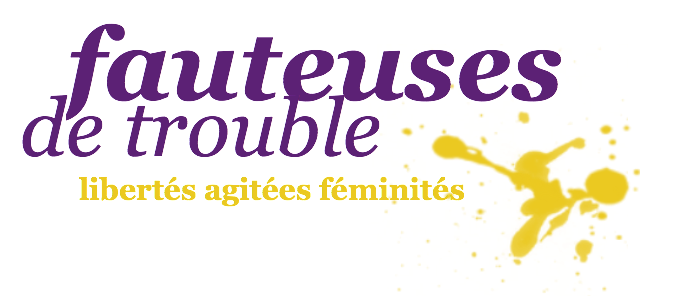


Voilà une deuxième et attentive lecture qui devrait faire plaisir à l’auteur d’ « Arkansas »…