Excès latins – Le Satiricon de Pétrone et Fellini-Satyricon, Première partie : « Le Festin de Trimalchion »
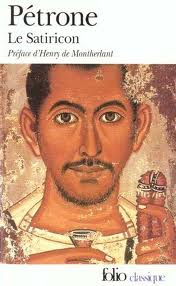 Question gourmandise littéraire et cinématographique, une référence s’impose : celle du Satiricon. Gourmandise excessive, voire orgiaque, certes. A l’attention d’iceux qui n’auraient ni vu ni lu ces deux chefs-d’œuvre de la péninsule italique, cet article se veut un amuse gueule… Et pour les autres, et bien, ce sera un digestif, ou mieux, un trou normand, qui j’espère donnera envie de se replonger dans ces aventures artistiques épiques et troublantes.
Question gourmandise littéraire et cinématographique, une référence s’impose : celle du Satiricon. Gourmandise excessive, voire orgiaque, certes. A l’attention d’iceux qui n’auraient ni vu ni lu ces deux chefs-d’œuvre de la péninsule italique, cet article se veut un amuse gueule… Et pour les autres, et bien, ce sera un digestif, ou mieux, un trou normand, qui j’espère donnera envie de se replonger dans ces aventures artistiques épiques et troublantes.
Tentons de situer l’insituable… Nous avons donc une première œuvre qui commence à dater, mais les spécialistes n’ont pas vidé leurs sacs, donc je ne m’aventurerai pas à vous dire précisément de quand. En gros, au début de notre ère, comme on dit. Pendant la Rome décadente. Tout un programme ! L’auteur serait Pétrone, mais là encore, c’est discuté. On va quand même dire Pétrone, ce sera plus simple. Parce que c’est déjà pas mal compliqué : le Satiricon est un roman (appellation traditionnelle mais encore une fois très discutable) qui ne nous est parvenu qu’en lambeaux. Un peu comme une fresque de Pompéi, si vous voyez le genre. Il y a pas mal de texte, mais pas le début, ni la fin, et il y a des trous dedans. Bien sûr on ne sait pas la longueur de ces lacunes. Ça commence bien, hein ? Je sens que vous n’avez pas du tout envie de lire. Grave erreur ! D’accord on ne sait pas toujours par quel bout ça s’attrape, mais quand on en tient un, c’est succulent ! Un drôle de gars, Encolpe, nous raconte ses aventures sulfureuses en compagnie d’Ascylte, son ami puis rival, de Giton, son bien aimé, et d’Eumolpe, poète qui passe son temps à se faire conspuer. Poursuivis par la guigne, ils traversent les bordels, les dîners, les tempêtes, les marchés, les cérémonies douteuses, les déserts, déguisés en esclave, ou en femmes, ou encore dans le plus simple appareil, dans les milieux sociaux les plus divers : hommes et femmes libres riches ou pauvres, philosophes, affranchi(e)s, esclaves, prostitué(e)s… Des péripéties, toujours, de l’unité, point. Ou alors celle de la diversité, comme celle de l’écriture : un joyeux mélange de prose et de vers, de comédie et de tragédie, de registres littéraires et argotiques, de récits et de discours. C’est peut-être ce que le titre signifie : un satiricon, ce serait d’abord une recette culinaire faite de restes, un mélange, un pot-pourri (satur veut dire rassasié). Qu’est-ce à dire, ce drôle de ragoût ? Michel Dubuisson (1) analyse l’œuvre comme volontairement inclassable, « un dynamitage des genres traditionnels, une intention délibérée de se situer en dehors des genres reçus ». Il faut lire cet article stimulant, qui arrive à la conclusion que cette « première description d’une pseudo-orgie romaine [doit s’imaginer] comme l’énorme canular d’une bande de joyeux drilles rassemblés autour de Néron, qui bâtissent de toute pièce dans un univers onirique, fantasmatique, des personnages haut en couleur, des Bérurier au carré, dans un milieu absolument invraisemblable et qui n’a jamais existé nulle part. » Du roman postmoderne avant l’heure ?
 Presque deux mille ans plus tard, Fellini reprend le flambeau, avec, semble-t-il, la même analyse de l’œuvre de Pétrone. Fellini Satyricon est pour beaucoup son chef d’œuvre. En 1969, c’est une bombe, « un Ovni, comme un cri, un point final poétique à la révolution hippie dont il utilise les artifices pour mieux les déstabiliser », écrit Jean-Max Méjean (2). Le cinéaste italien reprend la lettre du texte de Pétrone dans plusieurs séquences, et l’esprit de l’œuvre latine d’un bout à l’autre brillamment. Montrer la décadence contemporaine par le biais de la décadence historique, soit, mais sans discours lénifiant. Au contraire, cela passe par la reprise de la fragmentation du Satiricon originel (si non original), et les séquences s’enchaînent dans un film aussi onirique que fantasmatique, hypnotique, bref, fellinien. C’est une orgie pour les yeux et les oreilles, avec des costumes, des couleurs, des maquillages, autant de « beautés monstrueuses » qui peuvent faire référence aux fleurs putrides d’un Caravage ou d’un Goya. La musique de Nino Rota est au plus près de la définition du motsatiricon comme pot-pourri : « un mélange de tous les pays et de tous les genres » (2). De façon plus générale, « Fellini a réussi à réunir tous les arts théâtraux du monde : commedia dell’arte, théâtre Nô, cinéma expressionniste, danse, mime, etc. » (2) On le voit, le cinéaste rejoint le génial touche-à-tout Pétrone, en tout cas tel que l’analyse Michel Dubuisson.
Presque deux mille ans plus tard, Fellini reprend le flambeau, avec, semble-t-il, la même analyse de l’œuvre de Pétrone. Fellini Satyricon est pour beaucoup son chef d’œuvre. En 1969, c’est une bombe, « un Ovni, comme un cri, un point final poétique à la révolution hippie dont il utilise les artifices pour mieux les déstabiliser », écrit Jean-Max Méjean (2). Le cinéaste italien reprend la lettre du texte de Pétrone dans plusieurs séquences, et l’esprit de l’œuvre latine d’un bout à l’autre brillamment. Montrer la décadence contemporaine par le biais de la décadence historique, soit, mais sans discours lénifiant. Au contraire, cela passe par la reprise de la fragmentation du Satiricon originel (si non original), et les séquences s’enchaînent dans un film aussi onirique que fantasmatique, hypnotique, bref, fellinien. C’est une orgie pour les yeux et les oreilles, avec des costumes, des couleurs, des maquillages, autant de « beautés monstrueuses » qui peuvent faire référence aux fleurs putrides d’un Caravage ou d’un Goya. La musique de Nino Rota est au plus près de la définition du motsatiricon comme pot-pourri : « un mélange de tous les pays et de tous les genres » (2). De façon plus générale, « Fellini a réussi à réunir tous les arts théâtraux du monde : commedia dell’arte, théâtre Nô, cinéma expressionniste, danse, mime, etc. » (2) On le voit, le cinéaste rejoint le génial touche-à-tout Pétrone, en tout cas tel que l’analyse Michel Dubuisson.
Après cette petite introduction culturelle (ça ne fait jamais de mal), et pour illustrer ce numéro Gourmandises des Fauteuses, passons à la pratique et dégustons un extrait du fragment le plus connu (forcément, c’est le plus long et le moins lacunaire) : le Festin de Trimalchion.
La scène se passe assez tôt dans ce qu’il nous est parvenu de l’œuvre de Pétrone : Encolpe, Ascylte et Giton se rendent tous trois au dîner de l’affranchi Trimalchion. C’est l’occasion d’un récit dans le récit, sur « le thème bien connu du repas ridicule où un nouveau riche, un parvenu, cherche à éblouir ses hôtes par la bizarrerie des mets qu’il leur sert. » (1). Effectivement, on en prend plein les mirettes : en apéritif, olives, loirs saupoudrés de miel et de pavot, saucisses sur un faux gril constitué de pruneaux de Syrie avec des graines de grenade (ça imite les charbons incandescents, enfin !). Puis viennent des becfigues (ne me demandez pas ce que c’est) et du vin au miel en hors d’œuvres, auxquels font suite des pois chiches cornus, des testicules et des rognons, des figues d’Afrique, une vulve de truie stérile ( !!!), du fretin de mer, une huppe, une langouste, une oie et des mulets, tout cela ne servant en fait que de décorum à des volailles, lièvres et poissons. S’ensuit une fantastique chasse aux grives qui s’échappent du ventre d’un sanglier avant d’être rôties… C’est alors l’heure bien méritée de la pause digestive et des discours, pendant que les cuisiniers préparent le porc qui vient d’être choisi par les convives. Mais bien plus tôt que les invités ne le pensaient, voici ledit porc de retour :
(XLIX). Il [Trimalchion] n’avait pas craché toutes ses sottises, lorsqu’un plateau chargé d’un énorme porc parut sur la table envahie. Chacun d’admirer tant de diligence, et de jurer qu’un poulet n’aurait pu être sitôt cuit ; d’autant mieux que le porc nous paraissait bien plus gros que tout à l’heure le sanglier. Cependant Trimalchion, qui l’examinait de plus en plus attentivement, s’écria : – Comment ! comment ! ce porc n’est pas vidé ? Non, par Hercule ! il ne l’est pas. Faites, faites comparaître le cuisinier. – Et voilà l’esclave debout devant la table et penaud, qui dit qu’il a oublié. – Comment ! oublié ! Ne dirait-on pas qu’il n’y manque que le poivre ou le cumin ? Dépouillez-moi ce maraud. – Aussitôt fait que dit : on met tout nu le cuisinier, qui se tient d’un air piteux entre ses deux exécuteurs. L’assemblée intercède : – C’est une faute ordinaire ; nous vous en prions, faites-lui grâce ; s’il y retombe, aucun de nous ne sollicitera pour lui. – J’étais, moi, d’une sévérité implacable ; je n’y tenais plus, et, me penchant vers l’oreille d’Agamemnon : – Certes, lui dis-je, il faut que ce valet soit un fier vaurien est-ce qu’on oublie de vider un porc ? Non, pardieu ! je ne lui ferais pas grâce, ne s’agît-il que d’un poisson. – Trimalchion ne pensa pas de même ; et, déridant son visage tout épanoui de gaieté : – Eh bien, puisque tu as si mauvaise mémoire, vide-le devant nous. – Le cuisinier remet sa tunique, saisit un coutelas, entame par-ci par-là d’une main circonspecte le ventre de l’animal ; et soudain, par les ouvertures élargies sous le poids qui les presse, boudins et saucisses s’échappent par monceaux.
(L.) A ce coup de théâtre toute la valetaille applaudit, et cria en choeur : Vive Gaïus ! (3)
Voici maintenant la version fellinienne de la scène :
Le grand cirque de la vie et de la mort
Dans ces deux courts extraits, on voit bien que le festin n’est pas qu’une aventure gastronomique, mais une sorte de grand spectacle. Chaque nouveau plat fait l’objet d’une mise en scène particulière et soignée, où tous participent : les esclaves sont les acteurs, les convives sont les spectateurs diversement placés aux premières loges ou au poulailler, et Trimalchion orchestre la mise en scène générale. La comédie du porc en est très représentative et très signifiante, parce qu’elle aborde frontalement la thématique de la mort. On sait ce qui importe aux Romains : du pain, et des jeux. Et le grand spectacle est la mise à mort : il paraît que c’est ce qui attend le cuisinier pour sa faute, et il ne semble d’abord devoir sa grâce qu’aux invités suppliant le maître, tels les Romains au cirque. Ainsi mort et nourriture vont de pair, dans le grand cycle de la vie, ce que ne lasse pas de montrer le défilé des plats : les animaux tués pour nourrir les convives sont systématiquement présentés sous leur forme animale, jamais sous forme découpée. L’homme est le plus grand des prédateurs, et Trimalchion, en richissime affranchi, en est un de choix qui le revendique, en face duquel son esclave (qui n’a donc pas vraiment le statut d’homme), ne peut rien. Pourtant, c’était une blague… Pour mieux savourer encore l’instant présent… Il y a de l’épicurisme dans l’air. Les hommes sont moins que les mouches, entend-on, et il s’agit de jouir de la vie tant qu’on le peut : Trimalchion, philosophe à ses heures, n’a pas manqué de jouer avec un squelette d’argent un peu plus tôt sur sa table, et d’en tirer sentence :
O misère ! ô pitié ! que tout l’homme n’est rien !
Qu’elle est fragile, hélas ! la trame de sa vie !
Tel sera chez Pluton votre état et le mien :
Vivons donc, tant que l’âge à jouir nous convie. (3)
Florence Dupont, dans Le plaisir et la loi (4), voit dans le festin de Trimalchion une parodie du Banquet de Platon, notamment dans les discours qui accompagnent le dîner. Ainsi l’épicurisme de Trimalchion est-il passablement ridicule. D’autant plus que le riche parvenu a du mal à accepter sa propre mortalité : en témoigne cette scène avec un autre porc mort dans lequel se trouvent des grives vivantes, l’ensemble symbolisant le phénix renaissant toujours de ses cendres. Le porc, explicitement, est servi coiffé du bonnet des affranchis. Cette scène n’est pas dans le Fellini Satyricon, mais les constants jeux d’ombres et de lumières, notamment dans la scène du festin, peuvent aussi être une référence à la caverne platonicienne et à ses illusions.
©United Artists
La suite du festin file la métaphore : Trimalchion décide soudain de faire une répétition générale de son enterrement. Encore du théâtre ! Et des pleureurs, et des décors, et du maquillage… Du toc, en somme, ce à quoi ressembleraient sans aucun doute ses vraies funérailles. Mais il semble que l’héritage (et celui de Trimalchion n’est pas négligeable) puisse paraître aux yeux de l’affranchi une forme de renaissance, et il distribue ses bijoux aux invités qui se les arrachent comme des chiens affamés…Quelle meilleure fin de festin possible que de montrer, sous la forme d’une ultime illusion, l’avidité côtoyant la mort ? Le poète Eumolpe prend bonne note, et joue son plus beau tour de philosophe le jour de sa mort, soit presqu’à la fin de ce que nous connaissons du Satiricon. Il lègue tous ses biens à ceux qui rempliront l’unique condition requise : manger son cadavre. La boucle est bouclée.
Le festin de Trimalchion est donc bien plus que l’orgie théâtrale d’un parvenu excentrique à laquelle le jeune Encolpe assiste. La longueur de l’épisode et sa portée symbolique en font peut-être le signe d’une initiation plus sacrée : ne serait-ce pas la visite de la mort et des Enfers que le héros fait en spectateur bouche bée ? Deux autres détails vont dans ce sens : à l’entrée de la maison, un chien monstrueux est dessiné, comme celui qui garde le royaume souterrain des morts grecs et romains. Puis, alors que l’expérience du dîner devient trop pesante, Encolpe et ses amis tentent de fuir le festin, mais trouver la sortie de la maison de Trimalchion n’est pas simple. On ne sort pas par où on est entré (de même que la nourriture ingérée, hum): selon Michel Dubuisson, cette maison romaine n’a rien de romain, et serait une « transposition littéraire de l’image du labyrinthe, lui-même symbole traditionnel des Enfers. » (1). Fellini transpose superbement la contingence de tout et tous par la pétrification de son héros sur une peinture murale, partiellement détruite. Ce qui est encore une manière de célébrer la seule nourriture qui peut échapper à la mort, l’art. Alors, allez-y, régalez-vous sans aucune modération de ces deux chefs-d’œuvre.
Post scriptum : sur le rapport de la nourriture et la mort, resservez-vous en lisant la critique croisée du film La Grande Bouffe de Marco Ferreri !
Post scriptum 2 : Ceux qui sont attentifs auront bien noté que cet article est une première partie, c’est donc à suivre dans le prochain numéro et la prochaine Question… Laquelle ? Sachant que nos Satiricon seront toujours très concernés… Allez, avouez, vous avez déjà l’eau à la bouche !
Lire, relire : Pétrone, Le Satiricon, traduit par Pierre Grimal, Gallimard Folio Classique
Voir, revoir: Fellini Satyricon, MGM DVD
(1) Michel Dubuisson, « Aventure et aventuriers dans le Satiricon de Pétrone », Les Cahiers des paralittératures, 5, 1993. Article en ligne ici
(2) Jean-Max Méjean, Webzine « Il était une fois le cinéma, la passion du cinéma »
(3) Traduction de Nisard, Collection des auteurs latins, Dubochet (1842). Vous pouvez lire un extrait beaucoup plus long du festin de Trimalchion sur le site Méditerranée
(4) Florence Dupont, Le plaisir et la loi, du Banquet de Platon au Satiricon, Editions de la Découverte, 2002
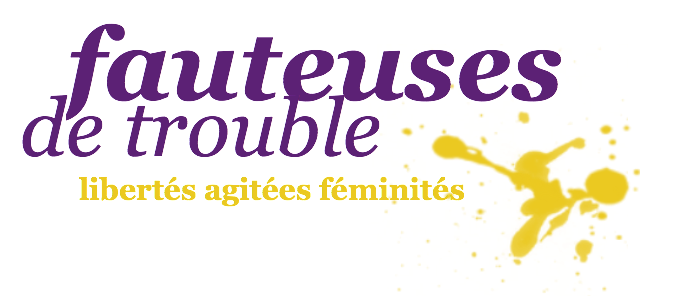


Commentaires récents