 À la merveille, celle qui émerveille. Si je devais résumer le cinéma de Terrence Malick en un mot, un verbe, ce serait « émerveiller ». Émerveiller le spectateur, s’émerveiller à l’écran. Malick aime explorer la façon dont les personnages vivent et expérimentent eux-mêmes cet émerveillement, que ce soit dans la relation à l’autre, à soi et au monde qui nous entoure. Cet émerveillement embrasse cette part d’inconnu qui nous échappe (à jamais ?), celle qui nous entraîne sur un chemin pas toujours bien tracé, celle qui nous rapproche de quelqu’un de façon irraisonnée, celle qui nous fait envisager une autre vision des choses. La vision de Malick est singulière, sensible, ancrée dans les sens. Elle se place au niveau de l’individu mais à une visée universelle. C’est cette vision qui nous fait dire sans la moindre hésitation : « Ce film est de Terrence Malick ». Peu de réalisateurs ont une telle patte qui les rend automatiquement identifiables. Le défi alors n’est plus d’essayer d’imposer ce style, cette vision, mais plutôt de ne pas tourner à la caricature.
À la merveille, celle qui émerveille. Si je devais résumer le cinéma de Terrence Malick en un mot, un verbe, ce serait « émerveiller ». Émerveiller le spectateur, s’émerveiller à l’écran. Malick aime explorer la façon dont les personnages vivent et expérimentent eux-mêmes cet émerveillement, que ce soit dans la relation à l’autre, à soi et au monde qui nous entoure. Cet émerveillement embrasse cette part d’inconnu qui nous échappe (à jamais ?), celle qui nous entraîne sur un chemin pas toujours bien tracé, celle qui nous rapproche de quelqu’un de façon irraisonnée, celle qui nous fait envisager une autre vision des choses. La vision de Malick est singulière, sensible, ancrée dans les sens. Elle se place au niveau de l’individu mais à une visée universelle. C’est cette vision qui nous fait dire sans la moindre hésitation : « Ce film est de Terrence Malick ». Peu de réalisateurs ont une telle patte qui les rend automatiquement identifiables. Le défi alors n’est plus d’essayer d’imposer ce style, cette vision, mais plutôt de ne pas tourner à la caricature.
C’est un équilibre fragile, que certains arrivent à tenir, et d’autres non. Le dernier exemple en date serait Tim Burton, dont les derniers films sortis ne ressemblent plus qu’à des machines burtoniennes (trop) bien huilées (à l’exception peut-être du Frankenweenie sorti en 2012). Malick semble avoir senti le danger, d’où sa décision d’envisager ses films comme des poèmes visuels. Il y avait déjà de la poésie dans ses films précédents, des moments oniriques qui laissaient pantois, émerveillés, mais cette poésie faisait partie d’un tout, d’une histoire plus ou moins développée mais tout de même présente. Dans À la merveille (To the Wonder, 2012), le poème prend le pas sur l’histoire et sur les personnages et, finalement, prend au piège les spectateurs au lieu de les entraîner à sa suite.
L’entrée en matière est aussi violente que béate : on rencontre un couple dans les premiers temps de leur histoire d’amour (Ben Affleck et Olga Kurylenko) alors qu’ils se promènent dans Paris et visitent le Mont Saint-Michel, enlacés, heureux, amoureux. Le film nous plonge directement dans cette ivresse grandiloquente que le personnage de Marina (Olga Kurylenko) personnifie à l’écran, et qui est appuyée par des plans méditatifs et chorégraphiés au point d’en devenir caricaturaux. Cette ivresse noie, aliène, au lieu d’emporter. Elle nous place de suite à l’extérieur et ne nous permet jamais d’y goûter. Comme ces publicités à la photographie léchée, aux protagonistes si beaux et aux paysages magnifiques, vers lesquelles on aimerait tendre, mais qui ne trouvent aucun écho en nous.
Comment se sentir interpelés par ces bouts de dialogues et de réflexions en voix off qui n’évoquent qu’une philosophie light, car trop épurée ? Comment ne pas sourire en entendant des phrases telles que : « L’amour qui aime… Merci. » ? Les quelques réflexions qui claquent (lorsque le Père Quintana parle du devoir d’aimer, par exemple) se retrouvent noyées dans la soupe de banalités et de clichés que Malick nous sert. Il n’y a rien de plus frustrant : voir ces quelques moments forts gâchés par un tout insipide.
Rien de plus frustrant aussi que de passer presque deux heures en compagnie d’inconnus pour qui on éprouve au mieux de l’indifférence, au pire du mépris. Le poème de Malick ne nous donne pas assez d’éléments pour comprendre ou sympathiser avec ses protagonistes, pas assez développés dans l’ensemble. Ce ne serait pas un gros problème en soi, si ce n’était que ça : les personnages de La Ligne rouge (The Thin Red Line, 1998) ne nous donnent à voir qu’une partie de leur être et de leur histoire, et pourtant le film bouleverse. Mais dans À la merveille, les personnages sonnent creux.
Le seul personnage féminin potentiellement intéressant, Jane (Rachel McAdams), n’apparaît qu’une quinzaine de minutes à tout casser ; dans cet intervalle, elle fait preuve de plus de puissance émotionnelle et de profondeur que Marina, le personnage principal omniprésent. Marina est une femme enfant par excellence : mariée à l’âge de 17 ans, maman très tôt, elle a conservé une innocence rafraîchissante au début du film, mais qui finit vite par devenir irritante. Malick nous martèle sa condition de femme enfant touchée par la grâce, la grâce de l’amour, elle qu’il filme le plus souvent de dos, jetant un coup d’œil par-dessus son épaule en direction de l’être aimé avant de s’élancer dans un champ/la rue/l’allée d’un supermarché tout en dansant dans ses jolies robes. Marina ne fait que danser et aimer. Danser avec un grand D, et aimer avec un grand A. Elle répète sans cesse à Neil (Ben Affleck) qu’elle l’aime, lui qui le plus souvent reste impassible, sans expression véritable. Elle a peur de trop lui dire qu’elle l’aime, mais elle a du mal à se retenir. C’est un être qui ne vit qu’à travers son amour pour l’autre, qui ne s’accomplit qu’à travers l’homme qui partage sa vie. Elle fait preuve d’une telle naïveté dans son comportement et dans ses sentiments que le doute s’installe : elle, elle doute de la viabilité de son amour ; les spectateurs, eux, doutent de la santé mentale de cette femme.

En face, il y a Neil, l’Américain qui passe les trois quarts de son temps dans la retenue et une passivité apparente. On dirait que cette histoire ne lui arrive pas à lui, qu’il la subit plus qu’il ne la ressent. La clé de ce personnage nous est donnée trop tard par le Père Quintana (Javier Bardem) : « C’est difficile d’être celui qui aime le moins ». Neil aime moins que Marina, mais en même temps, comment peut-il faire autrement quand on voit la dévotion extrême que Marina voue au sentiment amoureux ? Elle qui, comme une accro, se demande : « Pourquoi on redescend ? ». Elle qui prend en otage l’être aimé, et par la même occasion se condamne à être déçue, encore et toujours. Quand enfin Neil laisse entrevoir une vraie vie intérieure (une stupeur qui laisse place à une colère violente), il est trop tard aussi. Trop tard pour qu’on s’intéresse à ce personnage et à ce qui lui arrive, à la révélation possible qu’il recherche et trouve, peut-être, à la fin.
Je dis peut-être, car la fin laisse perplexe. Au lieu de réinstaurer une foi en ce poème et en l’amour en général, elle laisse gêné, dubitatif, agacé, déprimé. Quand je suis entrée dans la salle, j’étais bien décidée à ne pas sombrer dans le scepticisme ambiant, à ne pas me laisser gagner par les railleries que j’avais lues/entendues sur le film. Je voulais faire ce chemin vers la Merveille avec Malick, mais il m’a laissée sur le bord de la route.
À la merveille est comme Marina : sous couvert de célébrer la foi et le sentiment amoureux, il prend en otage et vide le spectateur de tout désir, de toute légèreté, de toute foi. L’approche théorique à la foi et à l’amour, incarnée par le Père Quintana, n’arrive pas à se mêler à celle de la pratique ; l’histoire du Père reste désespérément distincte de celle du couple d’amoureux. L’approche théorique de Malick est louable et pleine de potentiel, mais l’exécution ne suit pas, ne touche pas, n’émerveille pas.
Et c’est ce qui blesse le plus. Jamais encore un film de Malick ne m’avait fait plonger dans le pessimisme et le sarcasme. Jamais encore il ne m’avait laissée sur le bord de la route, comme si avec ce film, pour reprendre les mots de Jane, « ce qu’on avait n’était rien. Tu l’as réduit à néant » (« what we had was nothing. You made it into nothing. »). Un néant fait de jolies images. Un joli poème qui tourne à vide.
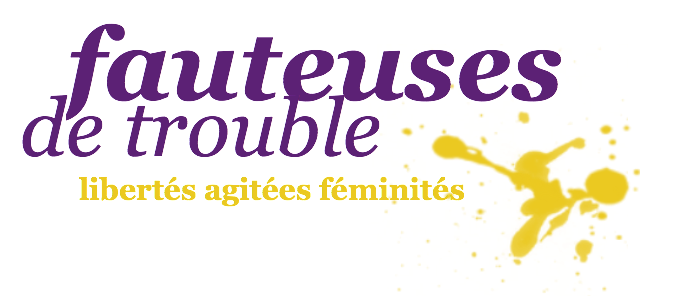


« Since its premiere at last year’s Venice film festival, To the Wonder has been giggled at a bit by pundits who are otherwise content to wave through every sort of passionless cinema that risks and achieves nothing. It does revisit some familiar images: the sunset glow, the intricate stained glass, the middle-American main street and front porch, and reportage-type quotation of scraps of dialogue from neighbours and onlookers whose faces loom into the camera. It occasionally comes close to self-parody, and in its final act, there is some visual and rhetorical redundancy. But these are the visible faults of a strong and powerfully distinctive film-maker. » (The Gardian).