Romans noirs, récit d’anticipation, pièce de théâtre, participation à des collections comme celle du poulpe : les occasions de lire Marin Ledun n’ont pas manqué depuis la publication de Modus operandi en 2007. En 2011, il frappe fort et vise juste avec Les visages écrasés, roman paru aux éditions du Seuil.
Un homme parvenu au bout de tous les rouleaux
Les toutes premières lignes nous amènent à la rencontre de Vincent Fournier, un vivant qui a déjà tout d’un mort, à commencer par « le visage cadavérique », un homme parvenu au bout de tous les rouleaux. Il se tient devant Carole Matthieu, le médecin du travail de son entreprise, la seule à l’écouter encore un peu, la seule à tenter de panser les nombreuses blessures infligées par son quotidien usant de salarié d’une grande entreprise de télécom. Dans une autre vie, Vincent Fournier était cadre supérieur, il avait « une secrétaire, des vacances aux Maldives et la moitié de ses primes payées en actions. » Mais c’était avant la fermeture de site, avant la mutation imposée, avant la reconversion en téléconseiller. Il n’est à présent qu’une petite chose qu’on presse infiniment. Peu à peu, il a descendu un à un les échelons de sa déchéance : il a connu les insomnies à répétition, une brutale perte de poids ou encore les cheveux qui tombent, il a tenté d’étrangler son « manager » après une humiliation de trop. Il est prisonnier d’une dépression qui s’éternise et qui le rend à la fois apathique et violent. Le Dr Matthieu sait donc qu’elle a devant elle un homme condamné qui va, durant cette ultime consultation, refuser la seule solution capable de le sauver, une solution qui tient à la fois du bon sens et du réflexe de survie :
« Vous devez quitter la société.
- Non.
- C’est la seule solution.
- Je peux pas. »
Il ajoute : « Ils ne m’auront pas. » Elle pense : « Ils t’ont déjà eu. »
Alors, ce patient qui n’en finit pas d’agoniser, Carole Matthieu va le soigner, « avec le traitement adéquat ». A la fin de sa consultation elle le drogue avec un puissant anesthésiant et, quelques dizaines de minutes plus tard, elle revient l’abattre d’une balle en pleine tête.
Voilà pour le prologue. A peine dix pages d’un roman qui en compte un peu plus de trois cents. Autant dire que ça commence fort et qu’il fallait, après ça, être capable de tenir le rythme et la distance.
« Je suis la plaie et le couteau ! / Je suis le soufflet et la joue ! /Je suis les membres et la roue, /Et la victime et le bourreau ! » (1)
Carole Matthieu a donc choisi d’agir. La mort de Vincent Fournier a pour elle un sens car elle a deux buts : abréger l’agonie d’un homme qui se décompose sous ses yeux et médiatiser la souffrance de tous les salariés qu’elle reçoit en consultation. Elle est donc prête à payer le prix fort, à abandonner sa liberté et son honneur. Tout, pourvu que cesse cette indifférence qui entoure la rédaction de chacun de ses rapports méprisés par sa direction.
« Je me suis préparée à me rendre sans résistance. J’ai pensé : menottes, garde à vue, préventive, cellule, avocat, procès. Mais aussi : médias, revue de presse, scoop, interviews. Je répète mentalement les mots que je dirai pour raconter l’histoire de Vincent. Je suis prête à me charger au maximum, à plaider la préméditation avec circonstances aggravantes. Je veux que l’entreprise raque, que ces actionnaires soient obligés de gratter les fonds de tiroir pour payer leur dette. »
On comprend rapidement que Vincent Fournier n’est pas le seul à être à bout. Dans son sillage se traîne la longue cohorte des hommes et des femmes qui n’en peuvent mais. Carole Matthieu, elle aussi, souffre, mais elle est bien décidée à ne pas se laisser faire. Elle va donc commencer une longue marche en avant, censée renverser le colosse qui lui fait face. Pour cela, il va falloir aller aux frontières de la morale et de la folie. Etrange femme que cette Carole Matthieu, kamikaze qui fait frémir, qui fascine, et qui devient presque attachante sans jamais, pourtant, être idéalisée.
« Tous coupables, tous innocents. »
Marin Ledun, comme il le fait lui-même remarquer dans son roman, veut rappeler l’origine du terme travail. « Tripalium » : instrument de torture à trois pieux. Ici, le travail n’élève pas, il rabaisse, humilie, fait souffrir. Ici, on ne « s’éclate » pas dans son « job ». On se décompose. A qui la faute ? D’abord aux règles du jeu de l’entreprise, règles dictées par le sacro-saint principe de rentabilité. Peu à peu, s’installe dans le roman une redoutable rhétorique faite de « manager », de « compétences » ou d’ « objectifs ». Seulement, tout en construisant son roman sur une indignation évidente, Marin Ledun parvient à éviter tous les écueils d’une simple démonstration. Bien malin, au fond, celui qui pourrait désigner clairement le coupable de ce système auquel chaque membre de l’entreprise, ou presque, collabore par ses haines, sa médiocrité ou ses silences. Peu à peu, dans le roman, les masques se lèvent et personne n’a les mains totalement propres, pas même les victimes de ce système. C’est ce qui fait l’extrême noirceur de ce roman, un roman qu’aurait peut-être apprécié Etienne de La Boétie s’il avait pu découvrir nos servitudes modernes, si proches de celles qu’il a lui-même étudiées :
« Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien ! Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons des vieux meubles de vos ancêtres ! Vous vivez de telle sorte que rien n’est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu’on vous laissât seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. […] Et de tant d’indignités que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les sentaient, vous pourriez vous délivrer si vous essayiez, même pas de vous délivrer, seulement de le vouloir.
Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. Je ne vous demande pas de le pousser, de l’ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. »(2)
« Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. » Le Dr. Matthieu entend bien ne plus servir, mais est-ce suffisant pour gagner la liberté ?
Écrire « l’autre histoire ».
Ce meurtre originel marque pour Carole Matthieu le début d’une nouvelle vie, une vie de fatigue, de mensonges et de fuite. Elle comptait se livrer mais elle va d’abord repousser l’arrestation. Le lecteur sent parfois son courage se fissurer et il la voit victime d’une crainte discrète mais palpable, celle de subir les conséquences de ses actes. Et comment pouvait-il en être autrement ? Seulement si elle repousse l’échéance, si elle laisse l’enquête se poursuivre en se taisant encore un peu, c’est aussi parce qu’elle veut avoir le temps d’écrire son histoire, celle qu’il faut laisser aux médias avant de partir. Encore quelques jours pour trier les rapports, fouiller dans les archives, percer les derniers secrets. Mais combien de temps avant de passer du statut de témoin à celui de suspect ? Déjà, un inspecteur lui tourne autour et elle va sentir, peu à peu, l’étau se resserrer. Le temps presse, donc, pour réunir les rapports qui ont été oubliés, les pièces d’un dossier qu’on a voulu enterrer, toutes ces sonnettes d’alarme qu’elle a tirées des années durant. Des confessions bouleversantes, des altercations entre employés, des viols, des tentatives de suicide, parfois réussies, des pratiques managériales qui poussent à bout pour mieux écarter d’un revers de la main. Carole Matthieu veut ainsi écrire ce qu’elle appelle « l’autre histoire », « celle des faits et de leurs résultats quotidiens, celle des hommes et des femmes qui ont atteint les limites de ce qu’ils peuvent endurer et qui préfèrent se balancer au bout d’une corde plutôt que de continuer à subir, mentir, taire, nier et refouler. » Va-t-elle parvenir à se faire entendre, à donner un sens à son sacrifice et à celui des victimes qui l’entourent ?
Le feu et la glace
Pour le savoir, il faut accepter de plonger dans ce roman noir, un roman qui vous prend à la gorge et ne vous lâche plus jusqu’à la dernière page et même un peu au-delà. Des jours après, on croit encore entendre l’histoire que nous raconte Carole Matthieu. Après un prologue éclatant, Marin Ledun parvient donc à tenir la cadence, faisant parfaitement varier les rythmes et les points de vue. Le choix de la première personne nous permet d’être au plus près de la colère et du délire, au sens étymologique, du personnage de Carole Matthieu, cette femme effrayante et touchante qui, après avoir longtemps écouté, se confesse dans ce long monologue, cette femme qui choisit de quitter le chemin qui semblait pourtant bien tracé. Mais l’une des grandes réussites de ce roman tient aussi dans les différents rapports qui se succèdent au fil du roman, des rapports médicaux ou professionnels, qui sont autant de moyens, pour le lecteur, de lire cette « autre histoire » chère à Carole Matthieu. Des rapports dans lesquels l’auteur pastiche avec brio un style distant, glacé mais brûlant de bassesse, capable de consumer et de faire froid dans le dos.
Marin Ledun livre sans doute ici son roman le plus réussi. Son lecteur retrouve des problématiques qui semblent lui être chères, et le monde décrit dans Les visages écrasés, par certains aspects, n’est pas si éloigné de l’univers dévasté qui nous était présenté dans Zone Est. Il nous laisse ainsi avec des questions, des constats sombres, alarmants, et, peut-être, quelques leçons à tirer. En somme, il fait le travail de tout bon romancier, car, comme l’a si bien dit Philippe Muray, « avant d’être « de la littérature », avant de dialoguer avec le reste de la littérature (catéchisme du vieux modernisme, liturgie des avant-gardes), un roman parle du monde. Et l’invente. Et le combat. Et s’en moque. Et le questionne. Et le montre. Et l’interprète. »
Le mot de la fin ? On le laisse à La Boétie, en guise d’hommage à Carole Matthieu, à beaucoup d’autres personnages de Marin Ledun et aux romanciers qui, eux aussi, veulent écrire, « l’autre histoire ».
Il s’en trouve toujours certains, mieux nés que les autres, qui sentent le poids du joug et ne peuvent se retenir de le secouer, qui ne s’apprivoisent jamais à la sujétion […]. Ceux-là, ayant l’entendement net et l’esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme les ignorants de voir ce qui est à leurs pieds sans regarder ni derrière ni devant. Ils se remémorent les choses passées pour juger le présent et prévoir l’avenir. Ce sont eux qui, ayant d’eux-mêmes la tête bien faite, l’ont encore affinée par l’étude et le savoir. Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et bannie de ce monde, l’imaginent, la sentent en leur esprit, et la savourent. Et la servitude les dégoûte, pour si bien qu’on l’accoutre.
(1) Baudelaire, l’Héautontimorouménos
(2) La Boétie, Discours de la servitude volontaire, Chapitre 4
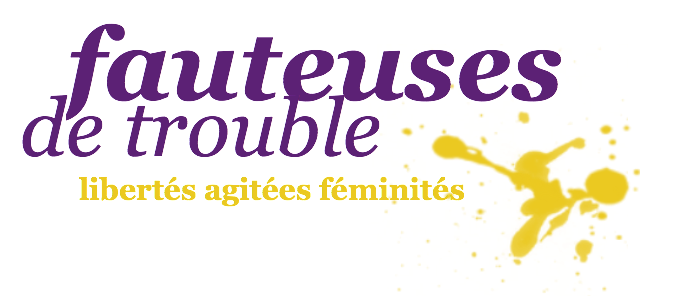
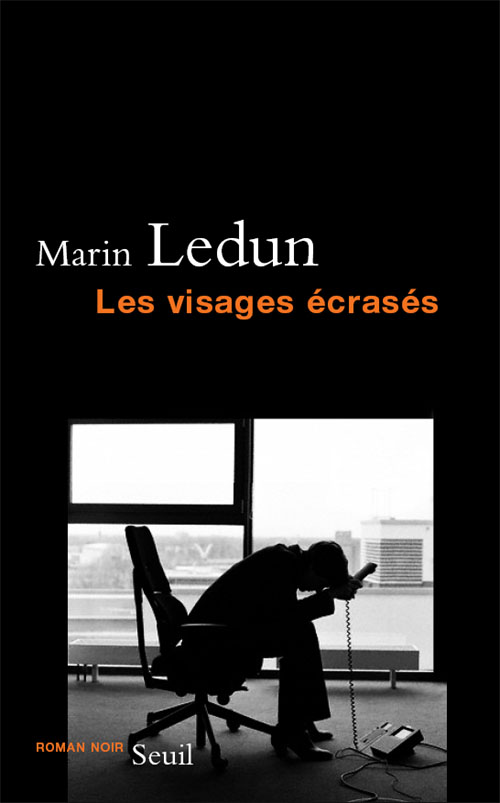


Commentaires récents