Critique théâtrale : La tragédie du roi Richard II, de William Shakespeare, mise en scène par Jean Baptiste Sastre.
Jouée au Festival d’Avignon en juillet 2010, en tournée en France et en Belgique à partir du 6 janvier.
Au départ, c’est du lourd.
Une pièce d’hommes. De pères, même, et de fils, entendu au sens large. C’est loin d’être la pièce la plus connue du grand Will, et surtout loin d’être la plus simple. Allez, on se concentre deux minutes et on s’accroche.
 Un drôle de roi d’Angleterre du XIVe siècle, Richard II, qui perd sa couronne et abdique au profit de son cousin
Un drôle de roi d’Angleterre du XIVe siècle, Richard II, qui perd sa couronne et abdique au profit de son cousin
Traditionnellement classée dans les Chroniques, ou Pièces historiques, elle met en scène un drôle de roi d’Angleterre du XIVe siècle, Richard II, qui perd sa couronne et abdique au profit de son cousin, le futur Henry IV (pas celui du cheval blanc, hein, mais l’Anglais). Evénement peu commun, qui scelle le destin d’un homme peu commun : Richard II a hérité du trône à l’âge de dix ans. L’héritage a sauté une génération, puisque son propre père est mort (il s’agit d’Edouard de Woodstock, dit « le Prince noir », tout un programme – malheureusement avorté). Evidemment à dix ans, il ne comprend pas encore tout, et en gros, la famille autour en profite pour monter en grade. Mais le petit Richard devient grand, et se rebiffe. Il devient cruel, et élimine par la manière forte les concurrents dissidents. Dans une complexité toute médiévale, plus personne n’y comprend plus rien, et Richard II est sommé de départager deux excellents chevaliers qui s’accusent mutuellement d’un crime terrible (genre à la Abel et Caïn), alors que c’est lui le coupable.
Vous suivez ? C’est à ce moment que la pièce de Shakespeare commence. Le roi va bannir les deux chevaliers, dont Bullingbrook, son cousin et très inquiétant rival. Il continue à faire n’importe quoi, comme de spolier le susdit cousin de son héritage pour aller faire la guéguerre en Irlande. Pour finir il se met tout le monde à dos, le cousin ramène sa fraise et pique la couronne, et le pays. Et fait zigouiller Richard. D’aucuns disent que c’est le début de la guerre des Roses, mais c’est une autre histoire, celle-ci est assez compliquée comme ça.
La magie Shakespeare, c’est de réussir à nous servir sur un plateau un personnage aussi abject, et à nous le faire aimer. Pour savoir comment il s’y prend, lisez, oyez, voyez.
Dans cette pièce moins connue, qui est pourtant une pièce de choix, Shakespeare, ce père du théâtre moderne, montre un personnage rempli de contradictions et de paradoxes. Pour les historiens, Richard II passe pour le précurseur de l’invention de la monarchie absolue, que Louis XIV chez nous mènera à son faîte. Pour cela, il développe les Arts, se fait mécène. C’est à cette époque que naît la littérature de langue anglaise (Les Contes de Canterburry, de Geoffrey Chaucer par exemple). La notion de patrie devient signifiante au détriment des multiples plus petites seigneuries, la terre d’Angleterre devient la Mère, épouse du roi, dont les membres du peuple sont les rejetons. Ecoutez donc Richard retrouvant l’Angleterre en rentrant de son expédition en Irlande :
Je pleure de joie.
Debout sur mon royaume. Enfin.
Terre amour. Je te salue. Je te caresse. […]
Je pleure. Je ris.
Je te retrouve ma terre.
Je te caresse de mes mains royales.
Terre douceur. Ne te donne pas à mon ennemi.
Ne donne pas tes plaisirs à son désir rapace. (Acte III scène 2) (1)
Une nouvelle conception du monde, source de conflits de générations.
C’est une nouvelle conception du monde, source de conflits de générations, ce que souligne à souhait la pièce : les pères (à savoir ici, les oncles de Richard II) sont désorientés, ne savent plus à quel Dieu se vouer. N’oublions pas qu’au Moyen-Âge, le Roi et Dieu, c’est bonnet blanc et blanc bonnet. Les fils (le roi, ses cousins) sont beaucoup moins scrupuleux. Oui, ils aiment leur patrie, leur terre d’Angleterre. Mais ils entendent autrement l’histoire de la représentation de Dieu dans la personne du roi sur terre. En fait, ils entendent surtout « représentation » : ce qui compte, c’est l’image, celle que l’on donne, et qui donne ou ôte le pouvoir. (Du Sarko-berlusco avant l’heure !)
Un roi qui devient non roi, mais toujours un peu roi
Et pourtant, il y a une vraie sincérité dans le Richard II shakespearien. Parce que c’est un roi qui abdique, un roi qui devient non roi, mais toujours un peu roi : oui, c’est compliqué d’être roi, et encore plus quand on ne l’est plus. C’est peut-être à ce moment qu’il l’est le plus, roi, d’ailleurs. C’est cette mue, ce passage d’une peau à une autre que Shakespeare nous donne à voir : du roi à l’homme. Le baroque bat son plein, celui qui dénonce l’illusion et la vanité de toutes choses. Et le roi d’exhiber la théâtralité de sa fonction, voire d’en rajouter une couche, puisque justement, on est au théâtre :
Donne-moi ce miroir. Je vais lire dedans. […]
Ce visage ?
Le visage d’un homme avec dix mille hommes à son service sous son toit.
Ce visage comme le soleil faisait baisser les yeux des courtisans.
Ce visage s’est voilé la face de tant de folies et perd la face à la fin devant Bullingbrook.
Ce visage : l’éclat d’une gloire fragile.
Visage aussi fragile que toute gloire.
(Il jette violemment la glace par terre.)
C’est fait. Cassé en mille morceaux.
Note bien, roi silencieux, la morale du jeu. (Ace IV, scène 1) (1)
Tout cela ne pouvait que séduire un certain Jean Vilar, à qui le théâtre doit ce que l’on sait. En 1947, pour la première Semaine d’Art en Avignon, qui deviendra le célèbre Festival, c’est Richard II qu’il choisit de monter et de montrer, pour la première fois en France.
Vous aurez compris qu’en décidant de jouer La tragédie du roi Richard II au Festival l’été dernier, dans la Cour d’honneur du Palais des Papes qui plus est (soit un bâtiment exactement contemporain de Richard II), Jean Baptiste Sastre s’attaque à du gros. Et sera attendu au tournant.
Jean Baptiste Sastre s’en fiche et faute le trouble.
Même pas peur ! Le metteur en scène balaye comme un fétu de paille ces paternités qui en auraient écrasé plus d’un. Et il entraine du beau monde avec lui : en premier chef, il se fait offrir une nouvelle traduction par Frédéric Boyer. Le concept de la traduction par celui-ci est stimulant : selon lui, il n’y a pas d’histoire moderne sans nouvelle traduction. Nos langues européennes se sont construites aux XVe et XVIe siècles sur d’immenses chantiers de traductions de la Bible, du patrimoine grec et latin ; c’est la vivacité d’une langue vivante qu’il recherche. Une langue vivante qui se déplace, qui s’empare de ce qui a précédé, quitte à la déformer. La traduction est une invention, non une répétition. On dépoussière, donc. On désacralise (encore !). On n’a pas peur de se traiter de « salaud », puisque c’est de cela qu’il s’agit. Mais on n’oublie pas la poésie, et on touche du doigt au sublime :
« Comment sous les yeux de mon père manquer de courage ? Et comment m’accuser moi-même ? Peureux, minable et pleurnichard, devant cet incroyable lâche ? Si ma langue attaquait mon honneur en choisissant cette ignoble injustice ou en prononçant une trêve indigne, je la déchirerais avec mes dents, cette petite esclave au service d’une peur renégate. Pour cracher ce lambeau sanglant à la figure honteuse de l’abject Mowbray. » (Bullingbrook, Acte I, scène 1). (1)

Sastre est là pour s’amuser. « Le théâtre, c’est un jeu ».
Fort de cette version nouvelle, vive, acérée (shakespearienne enfin !), Jean Baptiste Sastre s’entoure d’une équipe de choc : à la technique, André Serré et André Diot ; à la scénographie, Sarkis, plasticien arménien connu et reconnu ; sur le plateau, Denis Podalydès, Nathalie Richard, Axel Bogousslavsky, Vincent Dissez, Bruno Sermonne, Jérôme Derre… Il était même prévu la participation des écrivains Jean Echenoz et Pierre Michon, mais pour des raisons indépendantes de leur volonté, cela ne s’est pas fait. Pourtant, Florence Delay de l’Académie française prendra un rôle quasi au pied levé.
Ne vous méprenez pas : ce casting de mastodontes ne va pas plomber la scène. Tout au contraire, Sastre est là pour s’amuser. « Le théâtre, c’est un jeu », répète-t-il à longueur d’interviews. Une évidence souvent oubliée… Jouons, donc !
La première chose qui saute aux yeux, c’est la féminisation de la pièce. On l’a vu, c’est une pièce très masculine a priori. Tellement masculine que certaines mises en scène antérieures n’ont pas hésité à faire sauter les quelques demoiselles prévues par Shakespeare (la reine, une ou deux duchesses). Sastre fait juste le contraire : non seulement les rôles féminins sont conservés, mais certains rôles masculins sont joués par des femmes (rappelons qu’à l’époque de Shakespeare, il n’y avait que des hommes sur scène, le mot « actrice » n’existait pas !). Il s’ensuit ce qu’il s’ensuit. Ou comment complexifier davantage ce complexe Richard II, et révéler la part de féminité qui l’habite comme tout un chacun ? Une poupée à taille humaine est par ailleurs présente du lever au baisser de rideau (c’est une image, il n’y a pas de rideau…) : sa présence reste mystérieuse, et ne laisse pas de questionner. Témoin, auditrice, narratrice ? Elle est à coup sûr une des composantes majeures qui semble faire basculer, tout en douceur, la pièce de la tragédie à la fantaisie. Plusieurs éléments vont dans ce sens : la mise en scène s’autorise les danses, les chants, les anachronismes… L’univers est proche de celui du merveilleux, un brin décalé, en référence à l’Alice de Carroll : Frédéric Boyer rappelle que la pièce est pleine de jeux de mots, du fameux nonsense anglais, et Jean Baptiste Sastre l’introduit dans sa mise en scène.
Pas si léger pour autant.
Qu’on ne s’y trompe pas, la légèreté de la fantaisie est hautement étudiée. C’est Sarkis qui travaille l’espace scénique, et pour le plasticien, la mémoire et le temps sont un défi permanents. «Mon travail est toujours lié à la mémoire. Tout ce que j’ai vécu, y est. L’histoire, cependant, est comme un trésor. Elle nous appartient. Tout ce qui s’est passé dans l’histoire nous appartient. Tout ce qui s’est fait à travers l’humanité, dans la douleur comme dans l’amour, est en nous, et c’est cela notre plus grand trésor. Et tout ce que j’ai vécu, expérimenté et fait, c’est mon trésor. Et si on concrétise cela dans l’art, si on le rend visible, vivable, on peut voyager avec ces formes, on peut ouvrir des frontières au lieu de les fermer. » (Propos rapportés par Uwe Fleckner, dans « La bibliothèque du séismographe », http://www.sarkis.fr). Son dispositif, pour être minimal, n’en est pas moins hautement signifiant. Côté jardin, en diagonale, une longue poutre se consume à l’image des ravages du temps, et sert tour à tour de banc des artistes, de corde raide pour le funambule Richard II, ou d’obstacle à franchir. A l’opposé, le mannequin poupée trône derrière une table argentée, où les différents personnages se réfugient et se confient. Un unique projecteur suspendu à une corde traverse le plateau et rythme la pièce tel l’astre solaire, alors qu’une vidéo subtile brouille les repères spatiaux, entraînant le spectateur régulièrement ébaubi par des cris stridents dans un espace-temps indéfini, le fameux in illo tempore des contes de fées.
A l’opposé, le mannequin poupée trône derrière une table argentée, où les différents personnages se réfugient et se confient. Un unique projecteur suspendu à une corde traverse le plateau et rythme la pièce tel l’astre solaire, alors qu’une vidéo subtile brouille les repères spatiaux, entraînant le spectateur régulièrement ébaubi par des cris stridents dans un espace-temps indéfini, le fameux in illo tempore des contes de fées.
Dans cet espace, les acteurs évoluent dans de somptueux costumes créés par la magicienne Domenika Kaesdorf, d’inspiration quattrocento. Chaque détail est minutieusement réfléchi, et invite à penser, en accord avec les mots shakespeariens revisités par Frédéric Boyer.
Jean Baptiste Sastre a fait des choix. Certains sont limpides, ingénieux, esthétiques (la gémellité de Richard et Bullingbrook par exemple), certains suscitent un étonnement fécond pour une lecture nouvelle (voir la présence constante de la Reine sur la scène), d’autres le sont moins : pourquoi Aumerle, cousin fidèle de Richard, une des figures les plus tragiques de la pièce, est métamorphosé en bouffon du roi ? Charge à chaque sensibilité d’y trouver son compte… ou pas. Une chose est sûre : ce n’est pas un Richard II classique, et la filiation, si elle n’est pas reniée, est poliment mais sûrement mise à distance.

Ce qu’on en a pensé en Avignon.
Dans une programmation qui laisse (trop ?) peu de place aux textes dits classiques, et compte-tenu de l’histoire de la pièce, le spectacle de Sastre en a déçu plus d’un. Parmi les récriminations les plus amères, la nouvelle traduction, jugée beaucoup trop moderne et crue. Ceux que l’on pourrait définir rapidement comme appartenant à la génération des pères en ont été choqués. Mais c’est faire un mauvais procès à Shakespeare lui-même, auteur subversif et sulfureux en son temps ! Il y a fort à parier que ces mêmes personnes ne seraient jamais allées au Globe Théâtre il y a quelques trois cents ans.
D’autres (les enfants du théâtre ?) ont su se laisser enchanter, au sens premier du mot, par la mise en scène de Sastre, et ont loué les merveilleux petits détails d’une mise en scène portée par des acteurs brillants. Denis Podalydès, notamment, est vraiment à la hauteur du rôle de Richard II pourtant tout en paradoxes.
Y aller ou pas ? Telle est la question, comme dirait William.
Comme on ne juge jamais mieux que par soi-même, oui bien sûr ! Mais choisissez bien votre date : arrivez disponible, ouvert, prêt à vous laisser porter, tout en étant prêt à cogiter sec. Et revenez nous voir pour en parler, le débat sera riche, sans aucun doute !
(1) William Shakespeare, La Tragédie du roi Richard II, traduction de Frédéric Boyer, Editions P.O.L., 2010
Pour aller plus loin :
http://www.festival-avignon.com/ (pour des vidéos de rencontres entre l’équipe artistique et le public, avant et après le spectacle)
http://www.sarkis.fr/ (le site officiel de l’artiste contemporain)
http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=livre&ISBN=978-2-8180-0469-2 (pour lire les premières pages de la nouvelle traduction de Frédéric Boyer)
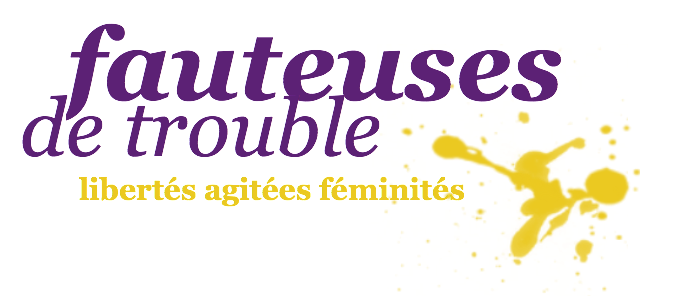


Commentaires récents