Voilà presque vingt ans qu’Hervé Le Corre œuvre dans le domaine du roman noir, notamment chez Gallimard, dans la « Série noire », puis aux éditions Rivages. Ses trois premiers romans viennent en outre d’être republiés aux éditions Pleine page. Peu à peu, il s’est installé parmi les auteurs français attendus et reconnus, comme en témoignent les nombreux prix littéraires reçus à l’occasion de la parution de son dernier roman Les cœurs déchiquetés. N’écoutant que son courage, il est le premier auteur de romans noirs à avoir accepté de venir fouler les terres des Fauteuses de trouble.

« L’écriture. L’oxygène. Une sorte de contrepoison »
Paul Art : Hervé Le Corre vous êtes à la fois auteur de romans noirs et enseignant. Vous faites donc partie de ces nombreux écrivains qui ont une activité professionnelle en plus de l’écriture. Est-ce pour vous un choix ou une contrainte, et comment parvenez-vous à concilier ces deux activités ? Vous enseignez le jour et vous écrivez la nuit ?
Hervé Le Corre : Je travaille pour gagner ma vie, puisque les ventes de mes romans restent trop modestes et donc peu rémunératrices. Raison donc très terre à terre. Maintenant, je ne pleurniche pas sur mon sort, parce que je ne suis pas sûr que j’aimerais ne faire que ça, écrire, rêvasser à ce que je vais écrire, ou lire dans le silence relatif de la lointaine agitation du monde. Faire l’écrivain, si on veut… Au risque de passer auprès d’âmes plus artistes pour un indécrottable lourdaud, j’aime encore ce boulot de passeur, (j’ai aussi mes moments de grande fatigue, n’exagérons rien non plus) et surtout, je trouve sain d’avoir, tout simplement, une vie sociale, professionnelle, avec toutes les contradictions et tous les conflits et même les déceptions que ça implique. Et les luttes, aussi, dont aucun aspect n’est méprisable, à mon avis : du mouvement social qui vient de se produire, massif, global, à la vigilance exercée sur les conditions concrètes de travail, il y a des bagarres collectives à mener pratiquement sans cesse. Sans parler de la contre réforme de l’École dans son ensemble entreprise par les néo-libéraux au pouvoir qui est une catastrophe dont on mesurera bientôt les effets dévastateurs.
Tout cela, c’est une partie de ma vie. Trente-trois ans d’usine, si on veut.
Ça nourrit terriblement, toute cette humanité-là, fût-elle parfois usante.
Les écrivains ayant une activité professionnelle constituent une écrasante majorité. On n’est plus à l’époque des écrivains rentiers du XIXème. Aujourd’hui, à part quelques starlettes médiatiques et de rares grands écrivains reconnus, la masse doit bosser pour croûter.
Et puis il y a l’écriture. L’oxygène. Une sorte de contrepoison, aussi, rapport à ce que je disais plus haut. Pendant le temps libre et les vacances qu’on nous concède encore, pour quelque temps, à nous feignants coûteux que nous sommes. Quand je peux. Quand j’ai l’envie, ou la force.
La nuit ? Je dors. Quelle banalité, n’est-ce pas ? Et le matin, je me lève souvent la rage au cœur et en traînant des pieds. Banal, aussi, décidément. Ordinaire.
P. A. : « Starlettes médiatiques » ? Vous nous livrez quelques noms ? Comme ça, instinctivement, on pense à un écrivain qui recopie wikipédia, ou à un autre qui a fait de la chemise ouverte sa marque de fabrique… D’ailleurs on trouve dans Les cœurs déchiquetés, l’ombre d’un mystérieux « écrivain à succès » participant à des parties fines et des orgies souvent peu reluisantes…
H. L. C. : Oui, bien sûr que je pense à ces gens, au battage énorme qui entoure la publication de chacun de leurs livres ou leurs postures qui en font des intellectuels de salon qui légitiment le cirque et son spectacle et ne dérangent rien ni personne, surtout pas l’ordre des choses, établi et maintenu avec leur consentement au moins tacite.
P. A. : Vous évoquez vos ventes encore trop modestes, mais votre dernier roman a pourtant raflé une bonne partie des prix qui comptent dans le domaine du roman noir. Citons notamment le « prix mystère de la critique », le « prix du roman noir » ou encore le « grand prix de littérature policière »… Le précédent avait également été remarqué par la critique et il avait aussi reçu quelques prix. Ca ne nourrit donc pas son homme les prix littéraires ?
H. L. C. : Les prix dans le polar sont très nombreux, comme dans la littérature « blanche », pour le dire vite et bêtement. Ils sont peu prescripteurs, même le Grand prix de littérature policière. Ils poussent un peu les ventes, mais ça n’a rien de spectaculaire. Ce sont des prix honorifiques qui expriment la reconnaissance d’un travail, et ça fait très plaisir à l’auteur et à son éditeur. Rien à voir avec les cinq ou six prix (sur des dizaines existant) de littérature générale d’ailleurs très médiatisés et leurs dizaines ou centaines de milliers d’exemplaires vendus.
P. A. : Je vous souhaiterais bien le Goncourt pour votre prochain roman afin de doper les ventes de vos ouvrages, mais le jury ne semble pas apprécier le roman noir. Je ne me souviens pas d’un seul roman noir sélectionné –je ne parle même pas de roman noir primé, ce serait la révolution !- ces dernières années. En même temps, je n’ai pas toutes les listes en tête, mais je ne pense pas me tromper. Que pensez-vous de cet « oubli » en tant qu’auteur de roman noir ?
H. L. C. : C’est l’histoire du bon vieux mépris à l’égard de la littérature dite « de genre », et singulièrement du roman policier ou noir, de la part de gens qui en ignorent tout ou en lisent en catimini. On pourrait épiloguer sans fin sur cette vieille dispute, qui d’ailleurs n’est pas sans intérêt sur le plan de la théorie littéraire ou de la sociologie. Cela dit, quand on voit dans quelles lamentables conditions, à chaque rentrée littéraire, se disputent les places dans les différents palmarès, à coups de polémiques bidons et d’emballements moutonniers, on peut se sentir, finalement, plutôt content d’être oublié par cette grande machine molle et plutôt stupide. Bien sûr, il y a Mathias Enard, Marie N’Diaye, ou Jean Echenoz qui viennent heureusement sauver l’honneur, exceptions qui confirment la règle.
P. A. : Au fait, comment êtes-vous venu à l’écriture ?
H. L. C. : Par la lecture. Par la rêverie dans laquelle ça me plongeait, ces histoires, ces personnages de papier, ces destins, toute cette machinerie imaginaire, ce piège fabuleux qu’est la littérature romanesque. L’envie d’imiter, d’abord, les écrivains que j’admirais, puis le désir de sortir de soi le texte idéal qu’on porte tous, jamais écrit, toujours à écrire, qu’on aperçoit au loin, parfois, comme un mirage ou une île d’utopie, cette musique par laquelle on voudrait attendrir les étoiles et qui ne parvient qu’à faire danser les ours, pour paraphraser Flaubert.
Et il y a cette envie qui tenaille alors on s’y met, on ose mettre ses petits pieds dans les pas des géants et on gratte sous la lampe, sans en parler à personne : des tentatives, des brouillons, des imitations, des exercices de style, bref, le régal des poubelles ou des fonds de tiroir (pas d’ordinateurs en ces temps-là !), et des lectures, encore : des romans beaux à pleurer, de la poésie qui, elle, parvient à l’harmonie, à l’accord parfait sauf que c’étaient des romans que je voulais écrire, comme un enfant aime s’entendre raconter des histoires et finit par les inventer dans ses jeux.
Et peu à peu ça prend forme. On a moins honte, on devient carrément présomptueux, on se prend à rêver que son petit caillou viendra loger parmi les blocs cyclopéens dans le grand mur de la littérature. Un jour, on est imprimé tout vif. « Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, Vous commandez des bocks ou de la limonade »…
P. A. : Et quel est votre rapport à l’écriture ? On sait que pour certains romanciers, chaque livre est un accouchement difficile, et que, pour le coup, l’écriture est un véritable travail pour filer la métaphore.
H. L. C. : J’aime écrire. C’est un vrai plaisir. Mon souci premier est celui du style : rythmes, sonorités, décalages. Mais le style ne saurait fonctionner à vide. J’aime écrire des histoires, des récits qui avancent, qui possèdent leur dynamique propre. Du roman à haute tension, ou haute densité dramatique. C’est en tout cas ce que j’essaie de faire, même si de ci, de là, on m’a reproché dans Les cœurs déchiquetés d’écrire des phrases trop longues et de perdre le lecteur dans des passages trop contemplatifs… Ce que j’assume pleinement, puisque c’est à peu près ce que je voulais faire, et tant pis pour les lecteurs pressés de thrillers et autres intrigues survitaminées.
Pourtant, il me semble qu’on peut obtenir de la tension par le style seul comme le font Ellroy ou McCarthy, par exemple, ou Russel Banks, à condition qu’elle soit réactivée par le souci du récit qui doit progresser et ne pas laisser l’écriture tourner à vide. Il y a un auteur qui travaille sur le fil de ce rasoir-là, c’est David Peace, dans tous ses romans, et particulièrement dans le dernier, Tokyo, ville occupée. Tension poétique, violence de l’écriture mêlées à la dureté de l’intrigue elle-même. Roman haletant parce qu’il se lit ainsi, comme une imprécation talonnée par l’urgence de pénétrer plus avant dans l’énigme du crime commis. À lire absolument.
« Le roman noir va voir du côté de la faute, de la transgression »
P. A. : Il y a dans votre production littéraire une constante évidente, depuis votre entrée en littérature : le noir. Pourquoi le choix du roman noir ?
H. L. C. : Une pente, plus qu’un choix. Le monde tel que je le ressens, en-deçà de toute analyse politique ou sociale et de la nécessité de garder au cœur et à l’esprit la vitale pulsion de l’utopie, des beaux lendemains, le monde, donc, m’apparaît le plus souvent comme un chaos désespérant, une taverne obscure aux mains de ruffians ivres et armés, prêts à tout pour garder l’usage exclusif des réserves de rhum. Et parmi les clients de ce lieu sordide et violent, des âmes perdues et des courages invraisemblables qui se débattent et se battent et parfois s’entretuent, se trompant le plus souvent d’adversaire. La métaphore est peut-être lourdingue, mais il me semble qu’on peut percevoir et analyser aussi, de façon instinctive, affective, le monde comme régi par une suite ininterrompue d’actes de piraterie et de massacres.
Le roman noir, pour moi, consiste à situer le récit et son écriture de ce chaos global à l’échelle des individus, des intimités, livrés à la violence, qu’ils soient victimes ou criminels, violence historiquement déterminée, construite, voire, parfois, encouragée.
P. A. : Le jeune Victor, dans Les cœurs déchiquetés, en vient à constater après l’assassinat de sa mère que « les mots sont inutiles ». On peut le comprendre, mais que pense le romancier des propos de son personnage ? Vos mots ont-ils selon vous une utilité ?
H. L. C. : Le personnage est rendu quasi mutique par la tragédie qui le frappe, et le langage ne lui est, croit-il, d’aucun secours, et il ne sait pas mettre sur ce qu’il ressent les mots qui pourraient ordonner la confusion opaque où il se trouve et l’en faire sortir (on pourrait parler aussi de K.O à son sujet). Je lui laisse donc l’entière responsabilité de ses pensées…
Quant aux miens, de mots, du moins ceux que j’écris, je ne me pose pas la question de leur utilité, sinon en tant qu’outils linguistiques permettant de s’exprimer. À la limite, si c’est le sens de votre question, la littérature, romanesque ou autre, n’a d’autre utilité que le plaisir furtif qu’elle procure, ce surplus d’humanité qu’elle confère à celles et ceux qui la lisent. Pour ce qui est de mes romans, non, au regard des critères habituels, économiques, politiques, sociaux, ils ne servent à rien, ne disent rien d’autre que la vision arbitraire, subjective, limitée du monde qu’ils essaient de donner.
P. A. : Un auteur de roman noir est-il nécessairement un fauteur de trouble ?
H. L. C. : Il me semble que c’est sa raison d’être, et sa seule utilité, pour prolonger la question précédente : provoquer, faciliter le trouble, semer un peu de désordre dans les représentations du lecteur, c’est d’ailleurs à quoi devraient aboutir tous les romans, quel que soit le genre auquel on les rattache. Quand je parle de trouble ou de désordre, ce peut être aussi la confusion d’un émerveillement, d’une stupéfaction. Pour moi, le roman fondateur fut Cent ans de solitude, de Garcia Marquez, lu à 18 ans, relu plusieurs fois depuis, et dont je ne me remets pas, après tout ce temps et toutes mes lectures, du trouble délicieux qu’il m’a causé. En cela, ce livre a fait bouger définitivement ma façon de lire et d’apprécier les romans, et ce trouble, donc, cette onde de choc, n’en finit pas de vibrer, réactivée par d’autres textes, bien sûr, encore heureux !
De plus, si je joue bêtement sur les mots, le roman noir va voir du côté de la faute, de la transgression, et par là-même se nourrit des situations troubles et ainsi dérange, parfois, le lecteur.
 P.A. : Et vous reconnaissez-vous des pères dans la littérature en général et dans le roman noir en particulier ?
P.A. : Et vous reconnaissez-vous des pères dans la littérature en général et dans le roman noir en particulier ?
H. L. C. : J’ai plein de pères. Outre le géant colombien que je viens de citer, je citerai Flaubert, que j’ai mis du temps à admirer, Rimbaud, mais là c’est un jeune père qui serait parti alors que j’étais encore enfant et dont la parole résonne comme un écho permanent et dont la légende se raconte partout ; Giono, dont j’ai lu à quatorze ans Regain (puis pratiquement tout le reste ensuite), où j’ai compris ( sans être capable de l’expliquer, bien sûr) ce qu’était le style, ce pas de côté, cette boiterie de l’écriture . Plus près de nous, et tant pis pour le vrac, Cormac Mc Carthy ou Faulkner. Erri de Luca. Je peux me réfugier dans les bras puissants de ces gens-là.
P.A. : Et des frères ?
H. L. C. : Je pense à Manchette, un grand frère, celui qui a montré la voie, celui qu’on voudrait imiter, et qui vous regarde avec ironie et gravité. Celui qui a déclenché vraiment mon désir d’écrire.
Je pense à Larry Brown, grand écrivain américain, mort trop tôt parce qu’il ressemblait de si près à ses personnages, dont je me sens proche et qui me bouleverse. Olivier Adam, aussi.
Une sœur ? Simona Vinci. Une Italienne. Comme avant les mères, Où sont les enfants ? sont des choses magnifiques (chez Gallimard).
Et des tas de cousins et de cousines.
P.A. : Merci d’avoir évoqué une sœur ! Vous me sauvez la mise parce que j’allais me faire taper sur les doigts par mes amies fauteuses avec mes questions trop fermées… Pas de mère en littérature du coup ?
H. L. C. : J’aimerais citer Marguerite Duras. Beaucoup se marrent quand je dis ça. Mais j’aime l’écriture de cette femme-là et les décalages qu’elle induit entre les personnages et la réalité qui est la leur. Les petits chevaux de Tarquinia, Le marin de Gibraltar, La douleur, entre autres, sont des textes considérables.
Sinon, Louise Labbé, Toni Morisson ?
P.A. : Le mois dernier, les lectrices des Fauteuses de trouble ont pu noter, avec Fatale de Jean-Patrick Manchette qu’une femme peut faire un excellent personnage de roman noir. Mais qu’en est-il des lectrices? Les femmes, lectrices ou auteur(e)s d’ailleurs, ont-elles, selon vous, un rapport particulier au roman noir ?
H. L. C. : Je n’en sais rien. Les femmes lisent bien plus que les hommes, des romans noirs ou pas, dans des proportions assez écrasantes, je le constate tout le temps.
Pour ce qui est des écrivaines, je les crois capables d’une violence plus profonde, plus fondamentale que les hommes. Moins spectaculaire, sans doute, mais implacable, sans concession. Elles sont aussi plus distantes avec les codes du polar, il me semble. Mais là, du coup, si on parle de roman noir, elles sont moins nombreuses.
« Ce que je voulais écrire, dans ce bouquin, c’est l’absence. Le deuil. La mort. »
P.A. : Après une plongée remarquable et remarquée dans le Paris de la fin du XIXème siècle avec L’homme aux lèvres de saphir, vous revenez dans votre dernier roman vers une ville très présente dans votre œuvre. On a certainement dû vous poser cent fois la question, mais quel lien vous unit à Bordeaux, cette ville qu’on voit d’ailleurs évoluer au fil de vos romans ?
H. L. C. : J’y suis né, j’y ai grandi. J’y connais des chemins d’enfance ou d’adolescence où j’allais seul, et dont les traces s’effacent, mais pas le souvenir, ni sur la peau quelques frissons.
Et c’est plus facile pour moi : je connais, j’en parle. Comme d’autres de Barcelone, New-York ou Pétaouchnok. La vraie vie n’est pas toujours ailleurs… pardon, Arthur !
P.A. : Puisqu’on est avec Arthur, j’ai envie de revenir sur « Rimbaud le fils », comme dirait Pierre Michon, pour appuyer votre précédente remarque sur cette grande figure de la littérature. Rimbaud est en effet présent dès l’épigraphe de votre roman, avec un très bel extrait du bateau ivre. Vous nous parlez de cette image de dérive qui semble avoir tant d’importance dans votre roman, au sens propre comme au sens figuré d’ailleurs parce qu’on va bien trouver un bateau ivre dans le roman ?
H. L. C. : L’une des dynamiques de ce roman, si on peut utiliser ce mot, est bien la dérive. Dérive et flottaison, pour rester dans la métaphore aquatique… Victor, le gamin, et le flic Vilar s’efforcent d’abord de ne pas couler (Victor a des angoisses de noyade, par moment, puis à la fin, se retrouve vraiment dans l’eau) mais n’ont plus guère de forces pour aller contre ce qui les pousse à la dérive.
 P.A. : J’en viens au thème de la paternité, parce qu’il est à l’honneur dans ce numéro des Fauteuses de trouble mais aussi parce qu’il semble occuper une place importante dans une partie de votre œuvre. Il y a en effet dans votre tout premier roman publié, La douleur des morts, un père qui cherche sa fille disparue. On trouve également, dans votre dernier roman publié, Les cœurs déchiquetés, un autre père, qui, lui, cherche son fils. Pour le lecteur, cette boucle est assez intrigante. D’ailleurs, Pierre Vilar, pendant son enquête sur l’assassinat de la mère de Victor, souligne, dans un geste dont il ne perçoit sans doute pas toute la portée symbolique, l’importance du père dans toutes ces destinées qui s’entrecroisent : « Vilar entoura sur son carnet le mot « père » d’une dizaine de cercles emmêlés ». Connaissant la situation de Pierre Vilar lui-même, qui imagine son fils aux mains des pires pervers, on pense ici aux cercles de l’enfer… Pourquoi ce leitmotiv de la paternité ?
P.A. : J’en viens au thème de la paternité, parce qu’il est à l’honneur dans ce numéro des Fauteuses de trouble mais aussi parce qu’il semble occuper une place importante dans une partie de votre œuvre. Il y a en effet dans votre tout premier roman publié, La douleur des morts, un père qui cherche sa fille disparue. On trouve également, dans votre dernier roman publié, Les cœurs déchiquetés, un autre père, qui, lui, cherche son fils. Pour le lecteur, cette boucle est assez intrigante. D’ailleurs, Pierre Vilar, pendant son enquête sur l’assassinat de la mère de Victor, souligne, dans un geste dont il ne perçoit sans doute pas toute la portée symbolique, l’importance du père dans toutes ces destinées qui s’entrecroisent : « Vilar entoura sur son carnet le mot « père » d’une dizaine de cercles emmêlés ». Connaissant la situation de Pierre Vilar lui-même, qui imagine son fils aux mains des pires pervers, on pense ici aux cercles de l’enfer… Pourquoi ce leitmotiv de la paternité ?
H. L. C. : Probablement parce que j’ai un gros problème avec ça ? Une frustration ? Un traumatisme ? Il faudrait que j’en parle à un psy mais je m’en fous, je vis pas trop mal avec ça et puis je prends sur moi, pour rester dans la topique freudienne.
Ce que je voulais écrire, dans ce bouquin, c’est l’absence. Le deuil. La mort. Essayer d’aller voir et de dire comment on parvient à vivre AVEC ça, en essayant de ne pas s’écarteler ou se disloquer dans cette contradiction, puisqu’on est SANS. Alors, il y a la mémoire, les rêves, et pourquoi pas des visions. Les fantômes. Le silence, aussi. Victor et Vilar parlent peu, ils font, comme ils peuvent. Et ce silence se peuple vite des voix qui se sont tues, comme disait Verlaine, et peut vibrer, comme un frisson d’air qui viendrait se poser là sur la peau, de présences fugaces.
Et puis je regarde, j’écoute ceux qui au fond d’eux sont des survivants et traînent ça et du coup marchent moins vite (ce qu’ils sont souvent seuls à savoir). Et les enfants que je croise au travail. La façon dont ils résistent ou s’effondrent face au deuil. C’est de tout ça que j’ai fait ce roman. L’intrigue policière n’est pour moi qu’un prétexte. Puisque les personnages cherchent, que ce soit eux-mêmes ou un autre, alors autant y aller franchement et utiliser les codes forts du polar qui ont en outre l’énorme avantage d’obliger l’auteur à maintenir la tension dramatique, à rendre dynamique le récit pour qu’il ne se perde pas dans les marécages de l’introspection ou de la psychologie de bazar, à coups de belles phrases un peu vides.
Pour aggraver mon cas, je peux ajouter que le seul père dans ce roman qui revendique un fils et s’en approche et finit même – certes, dans quelles circonstances !– par le tenir dans ses bras, c’est un tueur. On n’est pas sorti des ronces, pas vrai ?
P.A. : D’autant qu’il y a également dans les cœurs déchiquetés de nombreux pères disparus, morts ou absents : celui de Victor bien sûr, mais c’est en définitive chaque enfant du roman qui semble privé de père, jusqu’à des personnages « secondaires » comme Julien, l’enfant placé dans la même famille d’accueil que Victor, qui évoque ainsi son père : « Moi, j’en ai un, mais il est mort. Dans la salle de bain avec le fusil. C’est moi qui l’ai trouvé. » On pourrait multiplier les exemples. Malgré quelques beaux moments de répit et notamment de communion avec la nature pour le jeune Victor, le constat est plutôt sombre. Alors, Hervé Le Corre, il n’y a pas d’enfance heureuse ?
H. L. C. : Dans ce roman, sans doute non. Bien qu’il y ait Marilou, paradigme de l’enfance heureuse et belle.
Des gosses à ce point malheureux, j’en ai rencontré quelques-uns. Le coup de fusil dans la salle de bain n’est pas une invention totale.
Mais un roman, ce n’est pas toute la vie. On focalise, c’est tout. On peut aussi utiliser le grand-angle, ça change les perspectives.
P.A. : Un romancier doit-il, selon vous, nécessairement être père pour évoquer ce thème de la paternité ? On est en droit de se poser la question parce que certains parents adressent parfois un regard dédaigneux à ceux qui n’ont pas d’enfants, insinuant plus ou moins clairement qu’ils ne peuvent pas comprendre… Or, finalement, cette attitude interroge l’idée même de littérature, puisque de nombreux auteurs évoquent des expériences qu’ils n’ont pas vécues. Pierre Bergounioux, au tout début de La cécité d’Homère, rappelle d’ailleurs qu’ « Homère, qui a montré les combats dans la plaine, le tumulte, l’inconnu, Homère, dit-on, était aveugle. » Qu’en pensez-vous ?
H. L. C. : Un romancier peut parler de tout sans avoir vécu toutes les vies qu’il invente. Tarte à la crème basique : pas besoin d’être flic ou assassin pour en écrire des histoires. Même pas la peine d’aller chercher Homère. La littérature, il me semble, procède autant de la vision (sans aller jusqu’aux Illuminations de Rimbaud mais quand même, « je fixai des vertiges » dit tout de l’écriture, il me semble) que du point de vue.
P.A. : Et comment avez-vous abordé ce personnage de père qui refuse d’accepter la mort de son fils disparu et qui est hanté par le spectre de la pédophilie ? On imagine que la cohabitation avec ces thèmes lourds ne doit pas être facile.
H. L. C. : Ce personnage n’existait pas au départ, c’était juste un flic qui passait par là, dans l’histoire de Victor que je projetais d’écrire. Puis il me semblait qu’il fallait un contrepoids à ce que trimballe le gosse, et ce personnage s’est forgé d’un coup, tout tremblant dans sa tragédie. Puis le roman s’écrivant, j’ai creusé la question de la survie après qu’on a perdu ce qu’on aime le plus au monde, et comment ce monde apparaît alors comme un champ de ruines peuplé de fantômes ou de zombies qui ne savent pas qu’ils sont morts.
Il n’est évidemment pas facile de cohabiter avec des questions comme la pédophilie, mais personne ne m’a obligé à l’aborder, et puis, quitte à lasser, c’est un roman que j’écris, et l’écriture sert à tenir à distance l’effroi, elle permet d’ordonner un tant soit peu le chaos et même d’approcher les pires spécimens d’humanité, puisque, définitivement, les monstres n’existent pas.
P.A. : Justement est-ce que la question du style, de la mise en forme ne permet pas aussi de tenir un peu à distance un fond aussi sombre ? Pour l’auteur bien entendu, car pour le lecteur, cette forme ne renforce que l’impact du fond. Je me pose cette question car on sent chez vous un souci certain de la langue, une attention extrême au choix des mots et même au rythme de la phrase. Votre roman s’achève d’ailleurs sur un très bel alexandrin.
H. L. C. : Le travail sur le style oblige à maîtriser la manière de dire les choses, entre le silence aveugle et gêné et le trop plein de la complaisance. Du coup, je peux sans doute contrôler les affects qui me traversent. Maîtrise, contrôle, c’est là tout le travail sur l’écriture. On ne contrôle pas tout, on laisse échapper des tas de pensées et de mots, mais du moins s’est-on efforcé de tenir tout ce bastringue d’une main ferme…
Cet alexandrin, comme il est venu tout seul, je l’ai rendu boiteux en rajoutant l’adverbe « enfin », pour éviter que ça paraisse trop précieux…
P.A. : Avant de nous quitter, un récent coup de cœur de lecteur à faire partager aux Fauteuses de Trouble ?
H. L. C. : Ça ne date pas de ces derniers mois, le livre a paru en 2009 à la Série noire, mais c’est un roman sur la paternité : Les feuilles mortes, de Thomas H. Cook. On le trouve désormais en Folio policier.
P.A. : Le mot de la fin ?
H. L. C. : Merci de m’avoir reçu sur ce site insolent et chic.
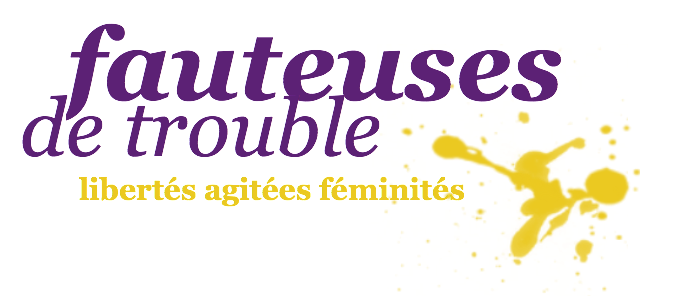


Commentaires récents