Emile Zola était un écrivain qui avait compris, dès la fin du XIXème, qu’il ne suffit pas d’écrire un bon roman pour devenir un auteur à succès. Lorsqu’il publie Nana, en 1880, il est déjà assuré que de nombreux lecteurs ne manqueront de découvrir les aventures de Nana, la fille de l’héroïne de L’Assommoir. L’Assommoir, publié en 1877, avait connu un joli succès, et Nana avait disparu à la fin du roman : la voilà donc qui ressurgit dans un nouveau récit qui porte son nom. Seulement, avant même d’être publié en feuilleton dans le journal Le Voltaire, Nana va bénéficier d’une opération de communication sans précédent. D’immenses affiches recouvrent les murs de Paris,et des hommes-sandwichs arpentent les rues de la Capitale pour attiser la curiosité du futur lecteur. Nana est de retour, et cela doit se savoir. Les raisons de ce retour, elles, restent encore mystérieuses. Il faudra, pour en savoir plus, lire le récit de Zola… Créer le désir : toute l’histoire de Nana pourrait tenir dans cette habile stratégie publicitaire, stratégie très moderne et, par ailleurs, couronnée de succès.
En lisant les premières lignes du roman, les lecteurs espèrent donc, enfin, obtenir quelques informations sur le retour de cette Nana. Le roman commence par nous emmener au théâtre des Variétés, que le directeur aime à présenter, avec une certaine lucidité, comme son « bordel ». Les spectateurs sont tous venus voir cette mystérieuse Nana, qui tient l’un des rôles les plus importants de la pièce mais qui semble sortie de nulle part. Le spectateur, tout comme le lecteur du roman, voudrait donc en savoir un peu plus sur cette intrigante jeune femme…
L’opérette annoncée par l’affiche commence, mais toujours pas de Nana. Attiser le désir, encore et toujours. Le public commence à s’impatienter, le lecteur aussi. On trépigne, on s’énerve, on s’échauffe. Mais la voilà enfin qui s’approche, cette Nana jouant le rôle de Vénus. Dès ses premiers pas sur la scène, elle va charmer les spectateurs, sans posséder, pourtant, aucun talent pour le chant ou pour le théâtre. Il lui suffit d’être présente et d’être elle-même, pour que son corps allume dans l’œil de ceux qui la regardent la flamme du désir. Mais ils n’ont encore rien vu, ces spectateurs. Au troisième acte de la pièce, Nana va abattre ses dernières cartes, et mettre à genoux tous les hommes de la salle :
« On frappait les trois coups, des ouvreuses s’entêtaient à rendre les vêtements, chargées de pelisses et de paletots, au milieu du monde qui rentrait. La claque applaudit le décor, une grotte du mont Etna, creusée dans une mine d’argent, et dont les flancs avaient l’éclat des écus neufs ; au fond,la forge de Vulcain mettait un coucher d’astre. Diane, dès la seconde scène, s’entendait avec le dieu, qui devait feindre un voyage pour laisser la place libre à Vénus et à Mars. Puis, à peine Diane se trouvait-elle seule, que Vénus arrivait. Un frisson remua la salle. Nana était nue. Elle était nue avec une tranquille audace, certaine de la toute-puissance de sa chair. Une simple gaze l’enveloppait ; ses épaules rondes, sa gorge d’amazone dont les pointes roses se tenaient levées et rigides comme des lances, ses larges hanches qui roulaient dans un balancement voluptueux, ses cuisses de blonde grasse, tout son corps se devinait, se voyait sous le tissu léger, d’une blancheur d’écume. C’était Vénus naissant des flots, n’ayant pour voile que ses cheveux. Et, lorsque Nana levait les bras, on apercevait, aux feux de la rampe, les poils d’or de ses aisselles. Il n’y eut pas d’applaudissements. Personne ne riait plus, les faces des hommes, sérieuses, se tendaient, avec le nez aminci, la bouche irritée et sans salive. Un vent semblait avoir passé, très doux, chargé d’une sourde menace. Tout d’un coup, dans la bonne enfant, la femme se dressait, inquiétante, apportant le coup de folie de son sexe, ouvrant l’inconnu du désir. Nana souriait toujours, mais d’un sourire aigu de mangeuse d’hommes.
— Fichtre ! dit simplement Fauchery à La Faloise.
Mars, cependant, accourait au rendez-vous, avec son plumet, et se trouvait entre les deux déesses. Il y avait là une scène que Prullière joua finement ; caressé par Diane qui voulait tenter sur lui un dernier effort avant de le livrer à Vulcain, cajolé par Vénus que la présence de sa rivale stimulait, il s’abandonnait à ces douceurs, d’un air béat de coq en pâte. Puis, un grand trio terminait la scène ; et ce fut alors qu’une ouvreuse parut dans la loge de Lucy Stewart, et jeta deux énormes bouquets de lilas blanc. On applaudit, Nana et Rose Mignon saluèrent, pendant que Prullière ramassait les bouquets. Une partie de l’orchestre se tourna en souriant vers la baignoire occupée par Steiner et Mignon. Le banquier, le sang au visage, avait de petits mouvements convulsifs du menton, comme s’il eût éprouvé un embarras dans la gorge.
(…)
Un murmure grandit, comme un soupir qui se gonflait. Quelques mains battirent, toutes les jumelles étaient fixées sur Vénus. Peu à peu, Nana avait pris possession du public, et maintenant chaque homme la subissait. Le rut qui montait d’elle, ainsi que d’une bête en folie, s’était épandu toujours davantage, emplissant la salle. A cette heure, ses moindres mouvements soufflaient le désir, elle retournait la chaird’un geste de son petit doigt. Des dos s’arrondissaient, vibrant comme si des archets invisibles se fussent promenés sur les muscles, des nuques montraient des poils follets qui s’envolaient sous des haleines tièdes et errantes, venues on ne savait de quelle bouche de femme. Fauchery voyait devant lui l’échappé de collège que la passion soulevait de son fauteuil. Il eut la curiosité de regarder le comte de Vandeuvres, très pâle, les lèvres pincées, le gros Steiner, dont la face apoplectique crevait, Labordette lorgnant d’un air étonné de maquignon qui admire une jument parfaite, Daguenet dont les oreilles saignaient et remuaient de jouissance. Puis, un instant lui fit jeter un coup d’œil en arrière, et il resta étonné de ce qu’il aperçut dans la loge des Muffat : derrière la comtesse, blanche et sérieuse, le comte se haussait, béant, la face marbrée de taches rouges ; tandis que, près de lui, dans l’ombre, les yeux troubles du marquis de Chouard étaient devenus deux yeux de chat, phosphorescents, pailletés d’or. On suffoquait, les chevelures s’alourdissaient sur les têtes en sueur. Depuis trois heures qu’on était là, les haleines avaient chauffé l’air d’une odeur humaine. Dans le flamboiement du gaz, les poussières en suspension s’épaississaient, immobiles au-dessus du lustre. La salle entière vacillait, glissait à un vertige, lasse et excitée, prise de ces désirs ensommeillés de minuit qui balbutient au fond des alcôves. Et Nana, en face de ce public pâmé, de ces quinze cents personnes entassées, noyées dans l’affaissement et le détraquement nerveux d’une fin de spectacle, restait victorieuse avec sa chair de marbre, son sexe assez fort pour détruire tout ce monde et n’en être pas entamé. »
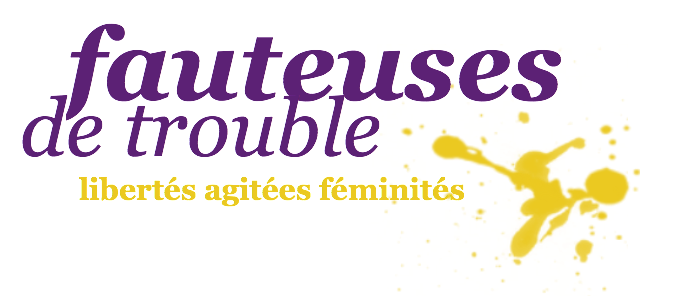



Commentaires récents